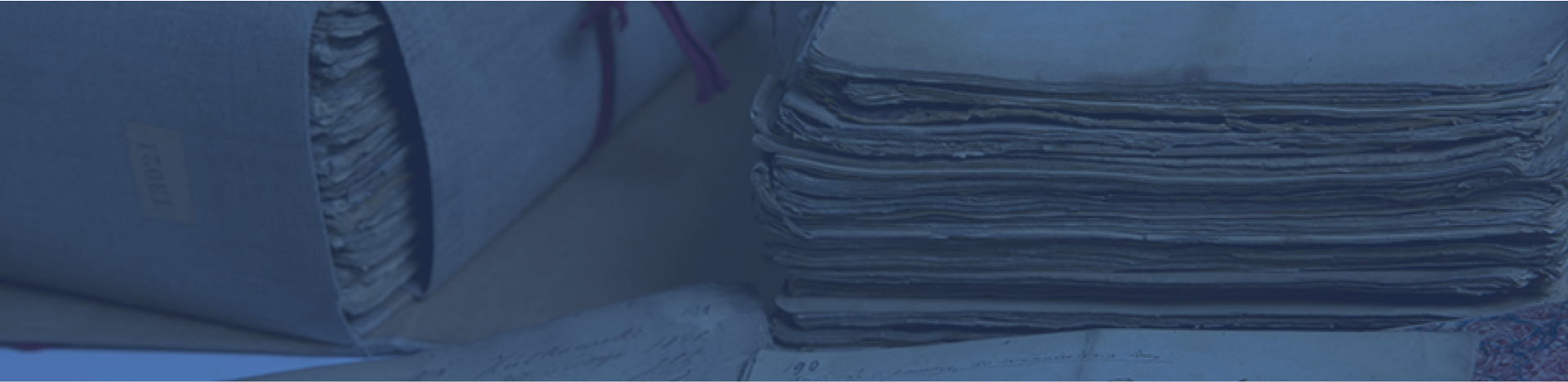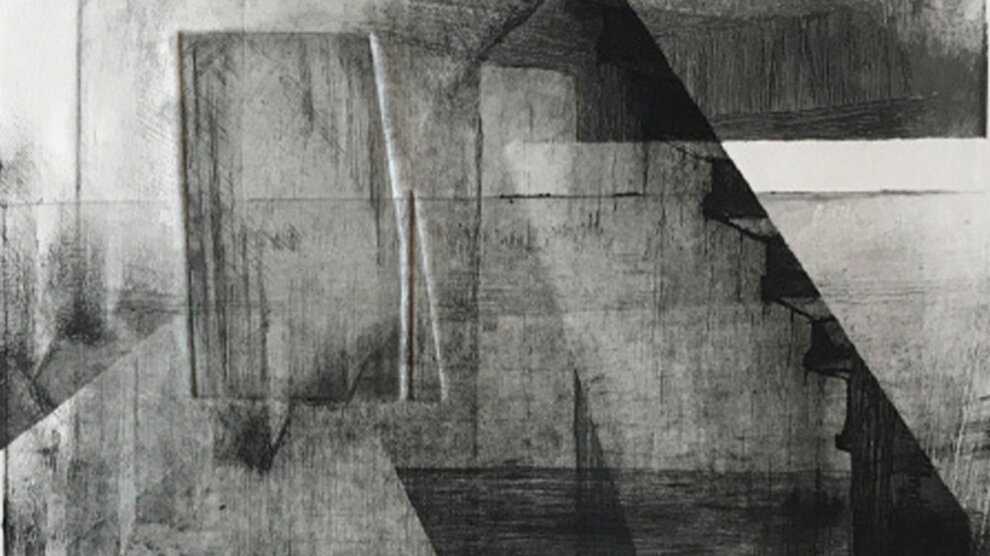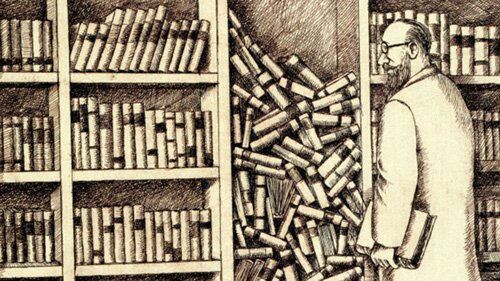Interview with Daniela Durán Cid
2023 winner of the Mattei Dogan Foundation Social History Prize
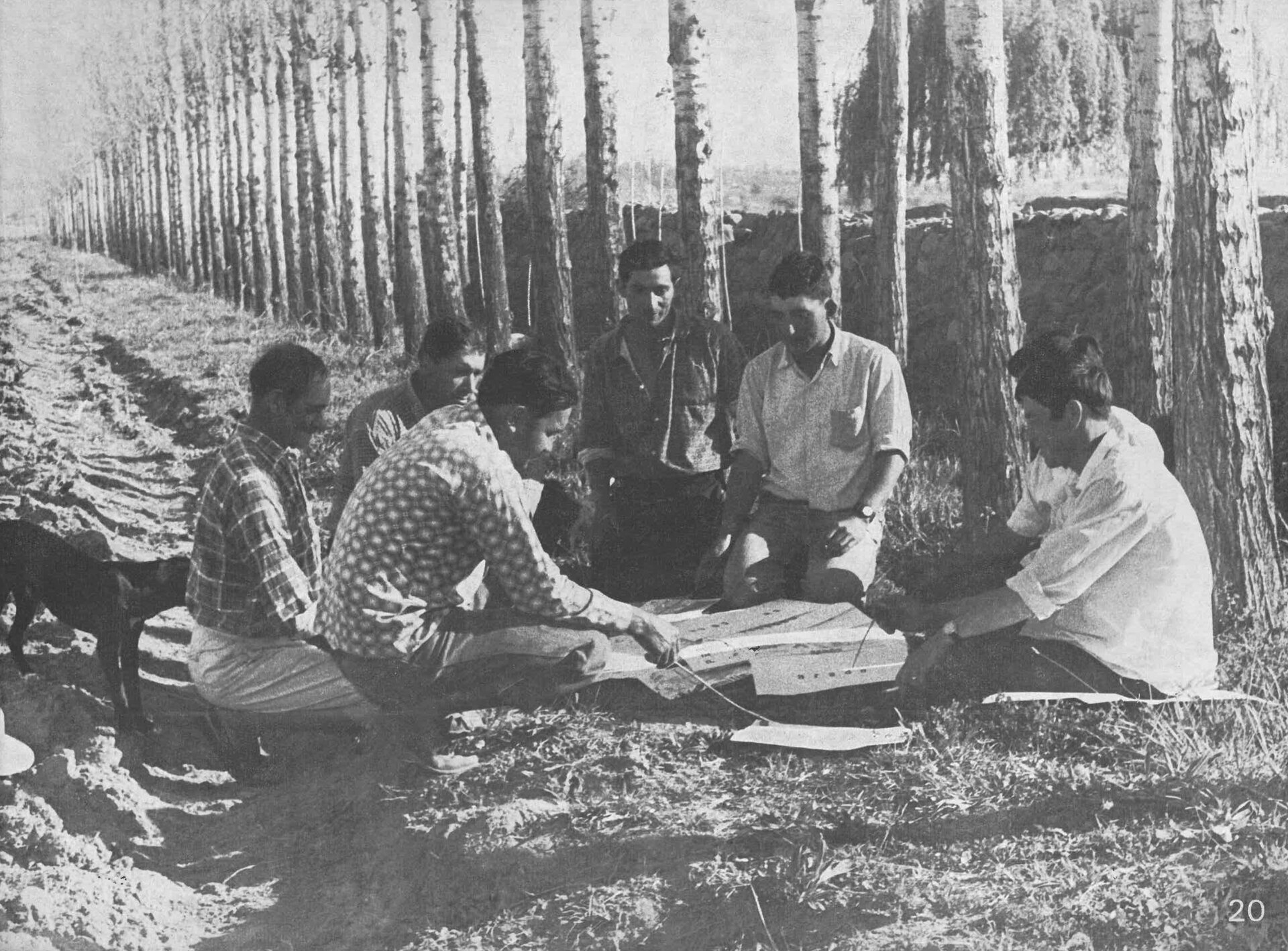
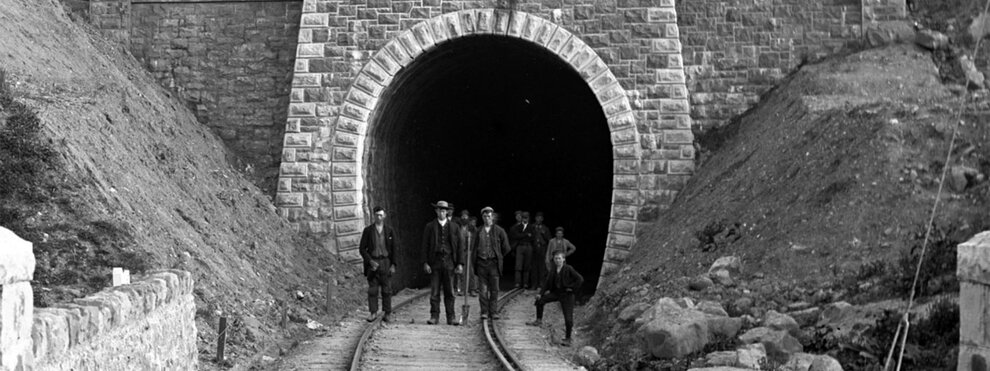
Social History Mattei Dogan Prize
Prize of the Foundation Mattei Dogan and of the FMSH for a thesis of excellency
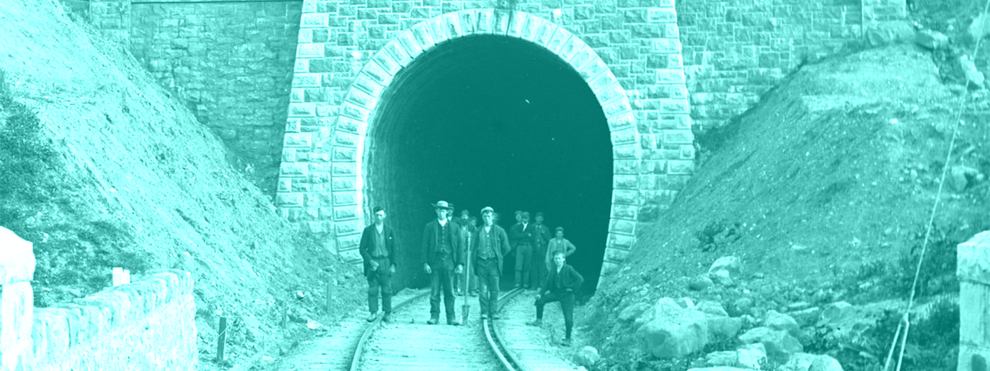
Laureates of the 2023 Social History Mattei Dogan Prize
Prize of the Foundation Mattei Dogan and of the FMSH for a thesis of excellency
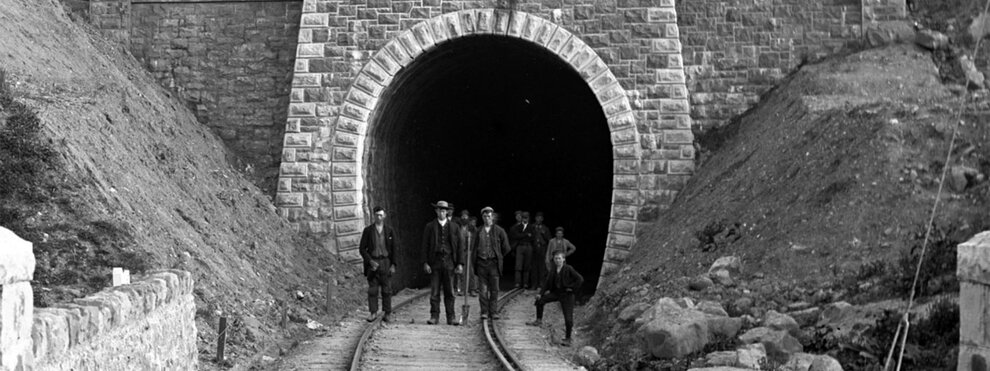
Mattei Dogan Award Ceremony
Award for outstanding doctoral theses on a social history
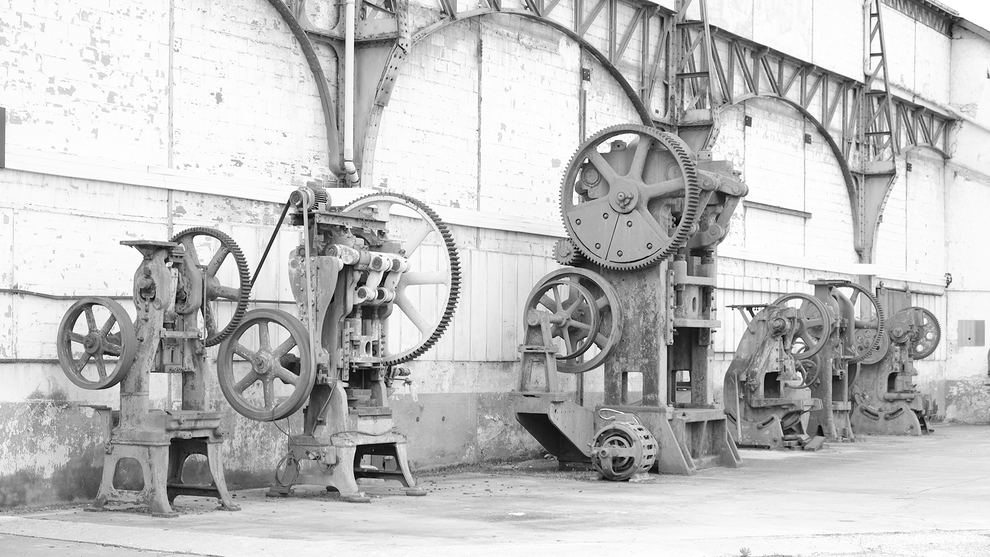
Interview with Jean-Christophe Balois-Proyart
Workers and manufacturers in the age of commodity capitalism. From the disincorporation of trades to the incorporation of work (France, 1789-1848)
Published at 16 January 2024