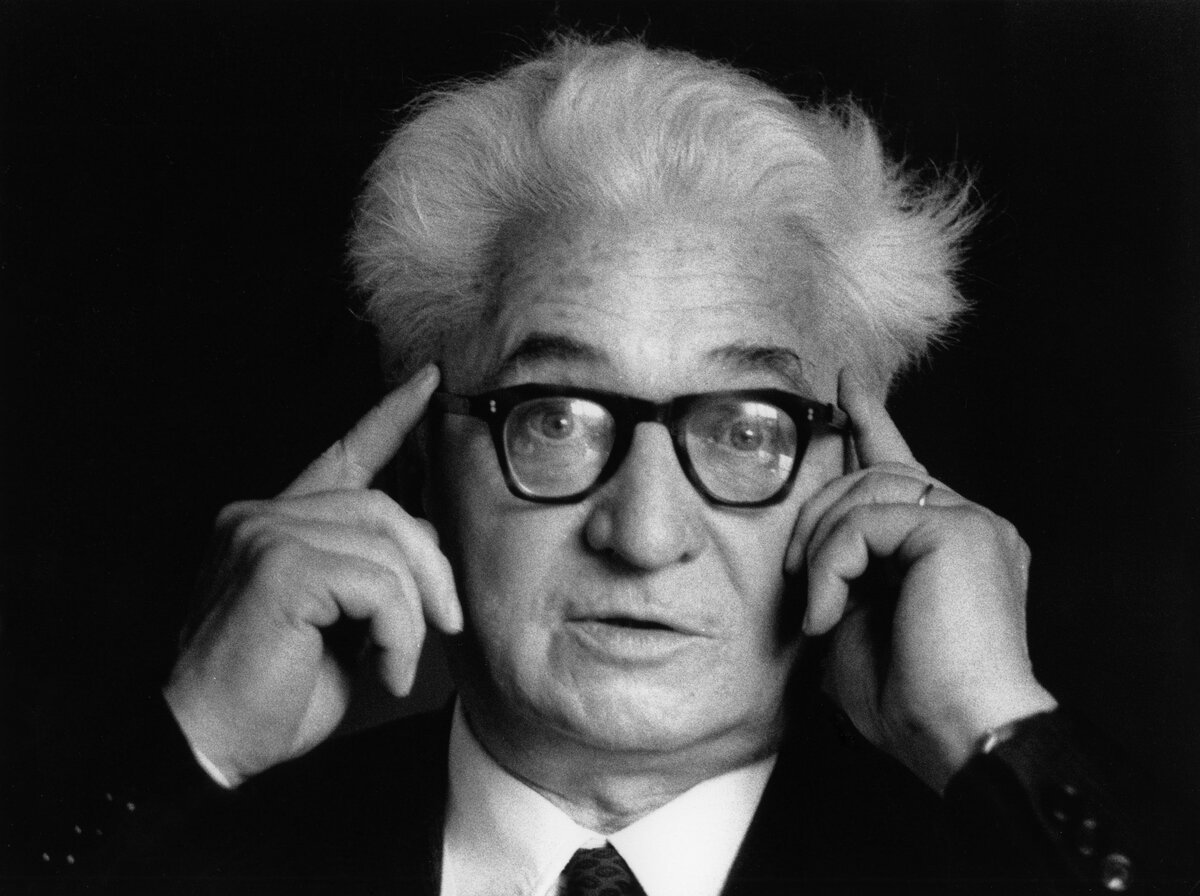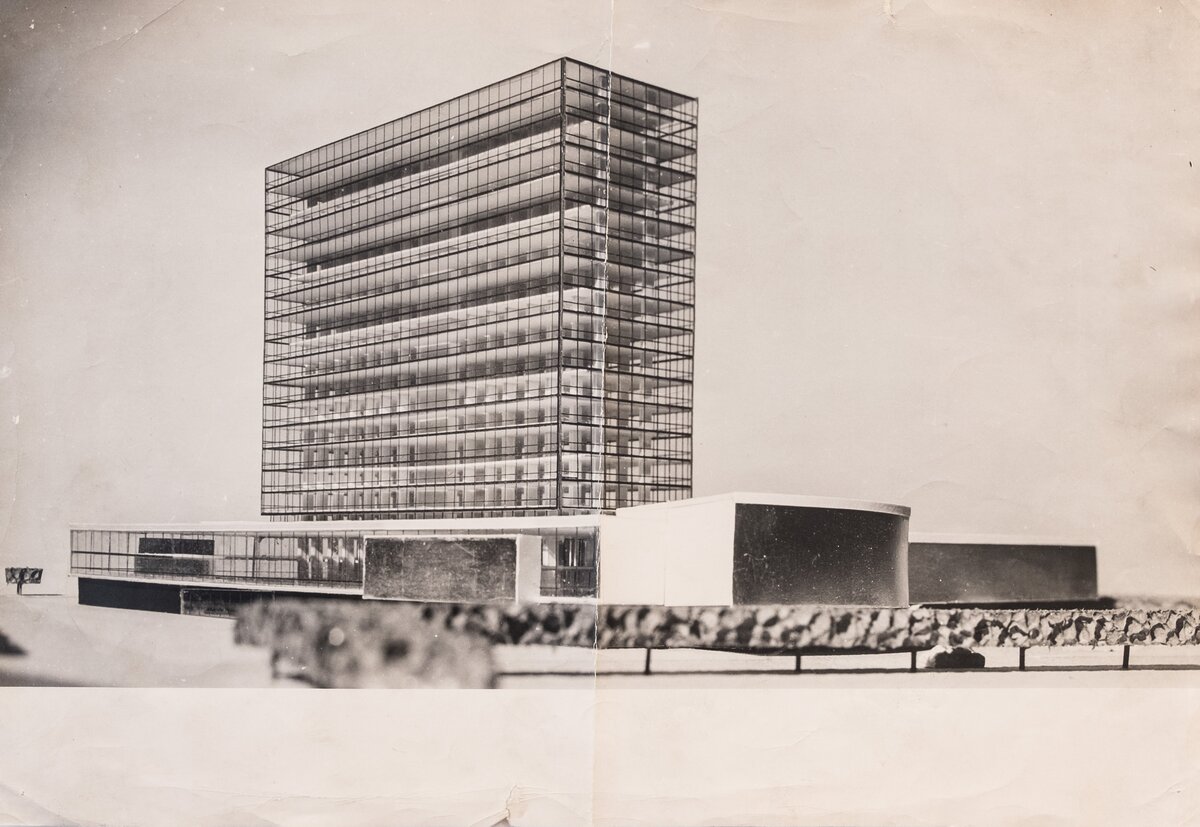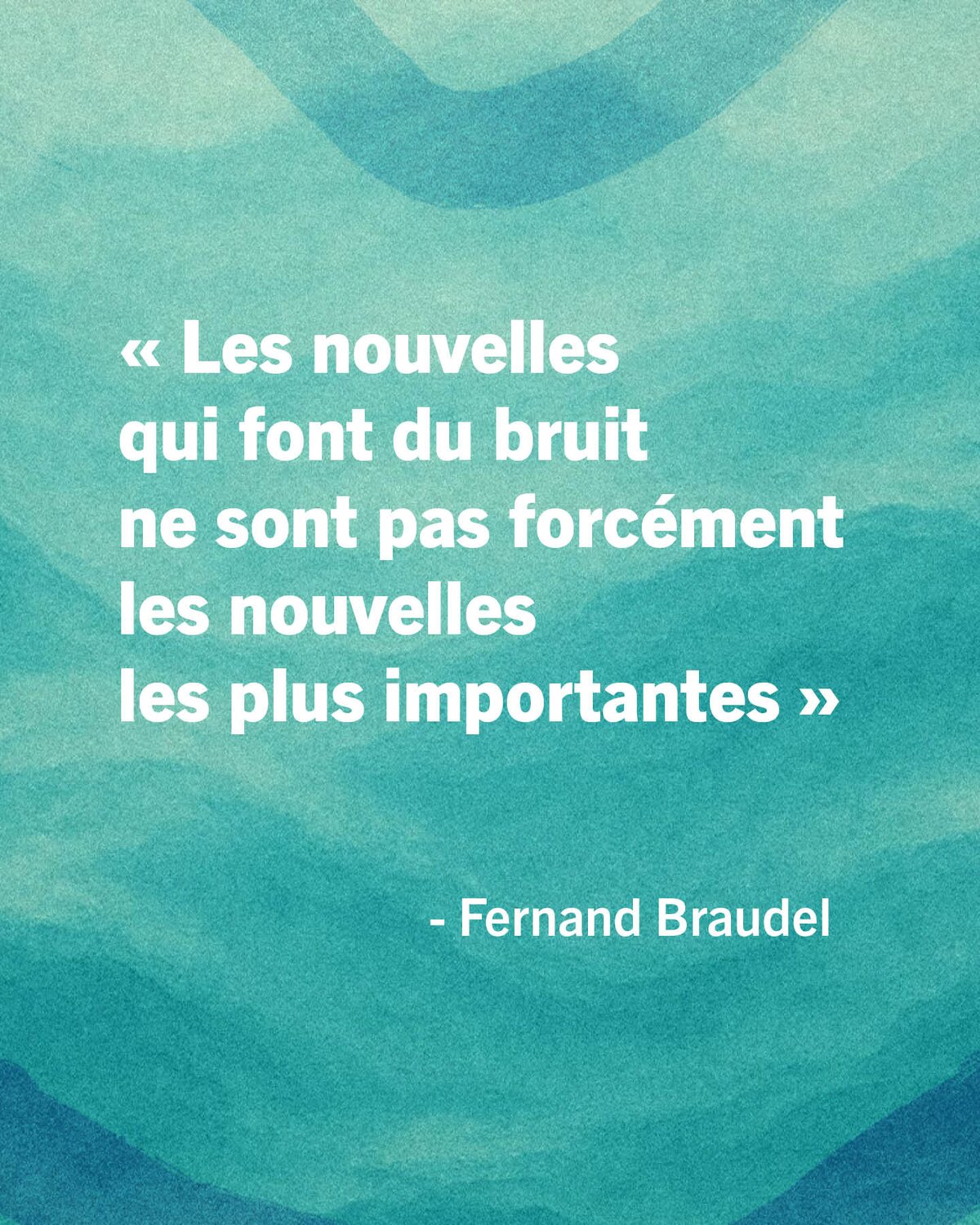Fernand Braudel : le temps long d’un chercheur d’exception

Les grandes dates de la vie de Fernand Braudel
Penser l'histoire avec Fernand Braudel
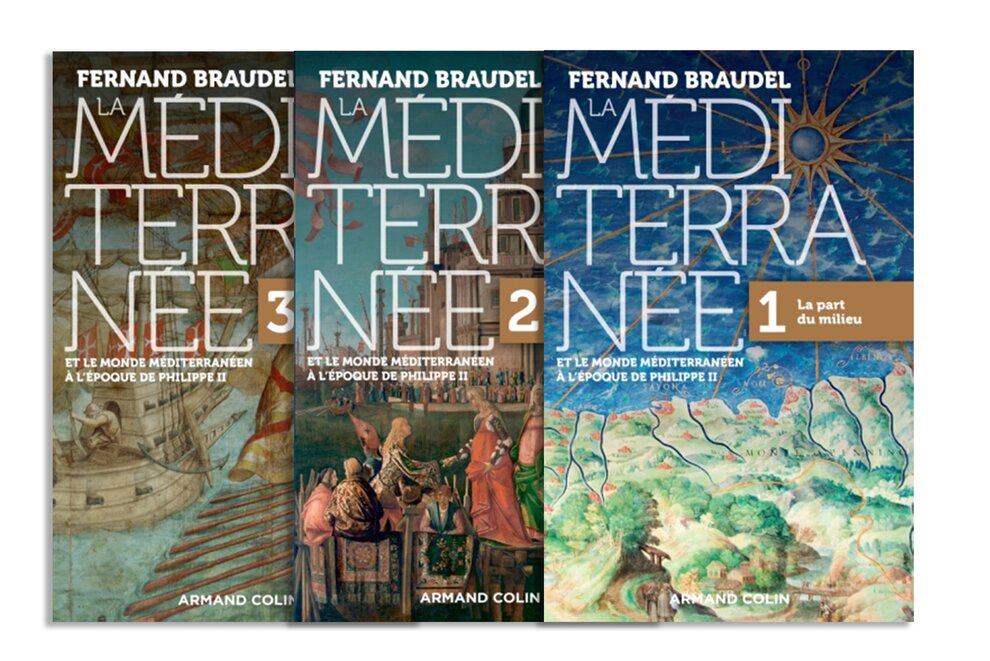
La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II
Paris, Armand Colin, 1949
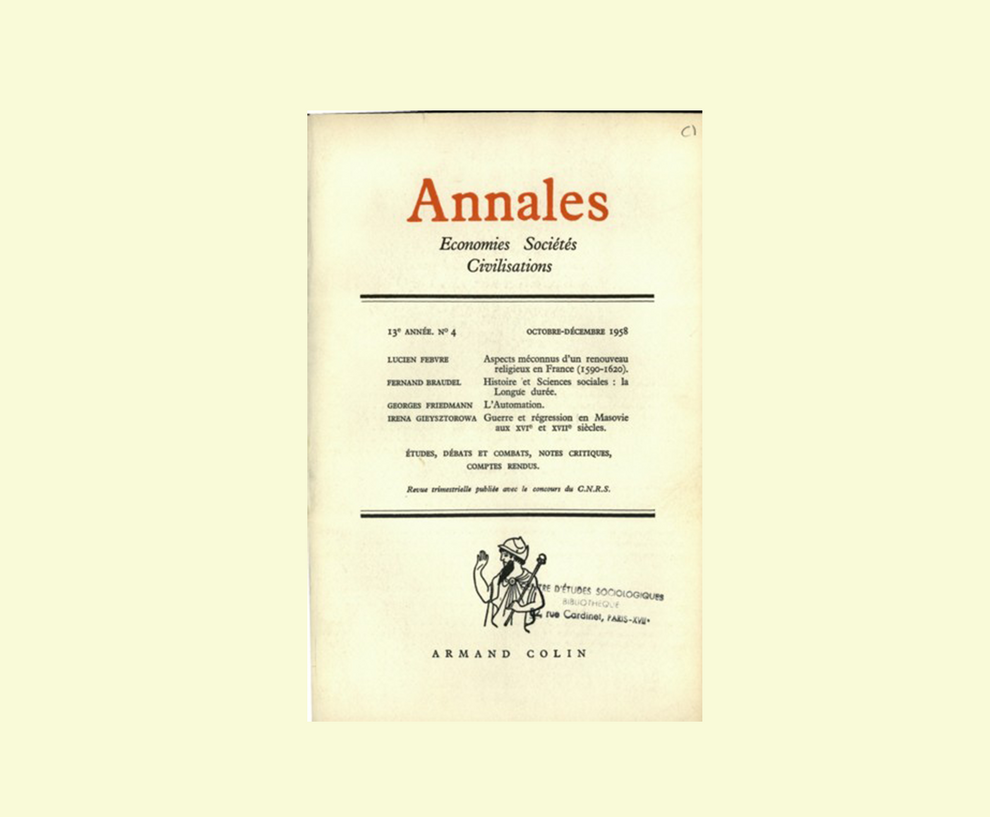
Histoire et Sciences sociales : La longue durée
In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 13ᵉ année, N. 4, 1958. pp. 725-753
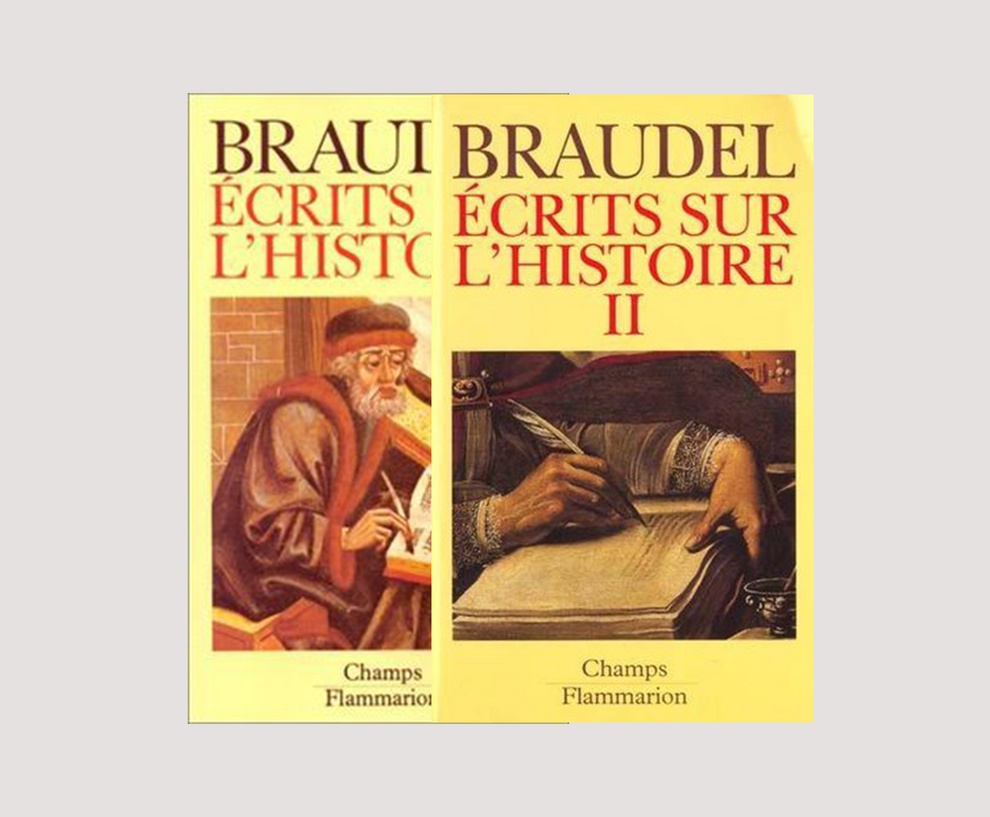
Écrits sur l'histoire
Paris, Flammarion, 1969
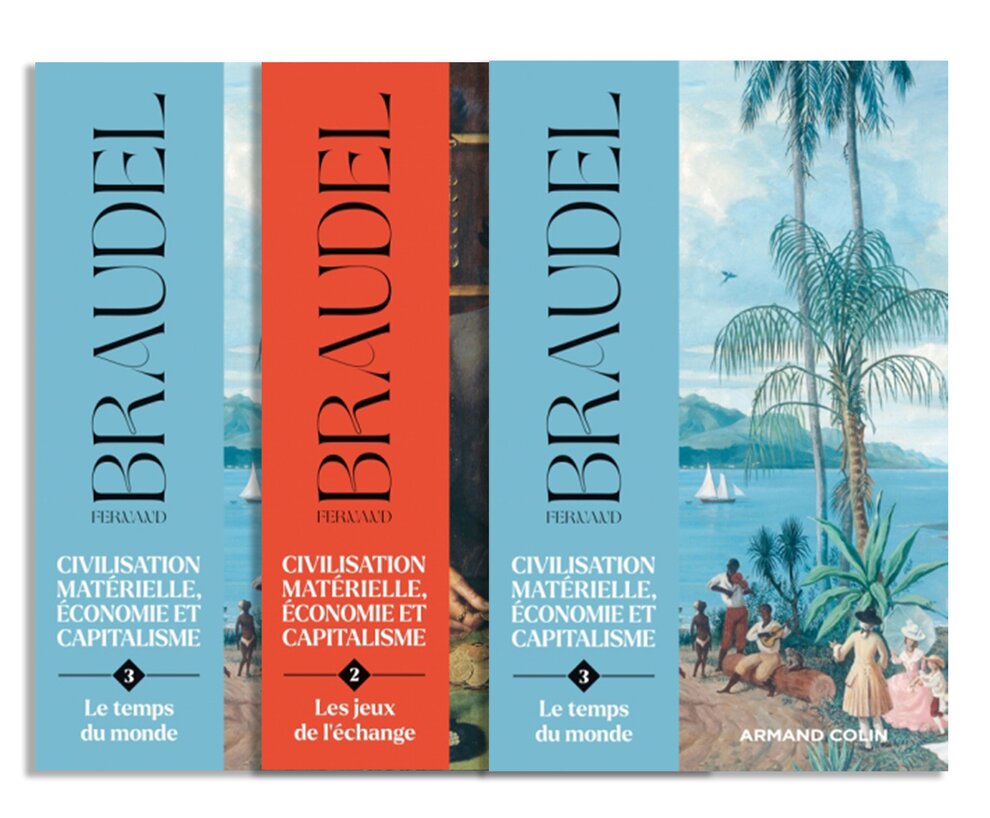
Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe–XVIIIe siècle
Paris, Armand Colin, 1979
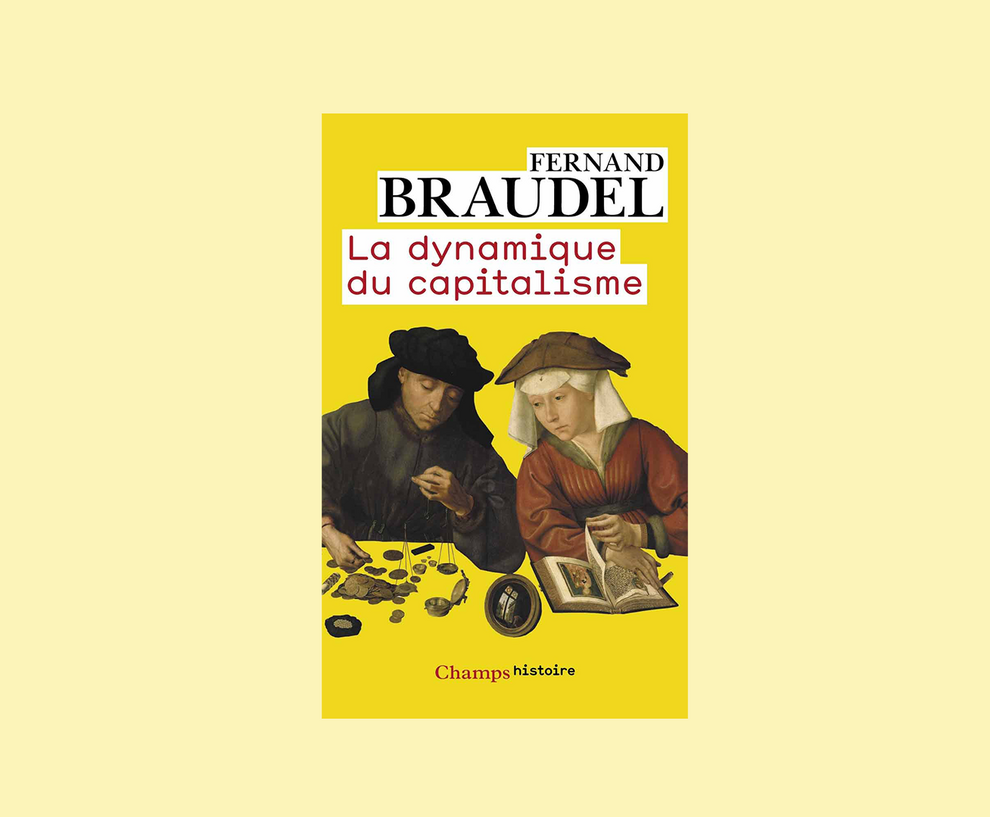
La dynamique du capitalisme
Paris, Arthaud, 1985
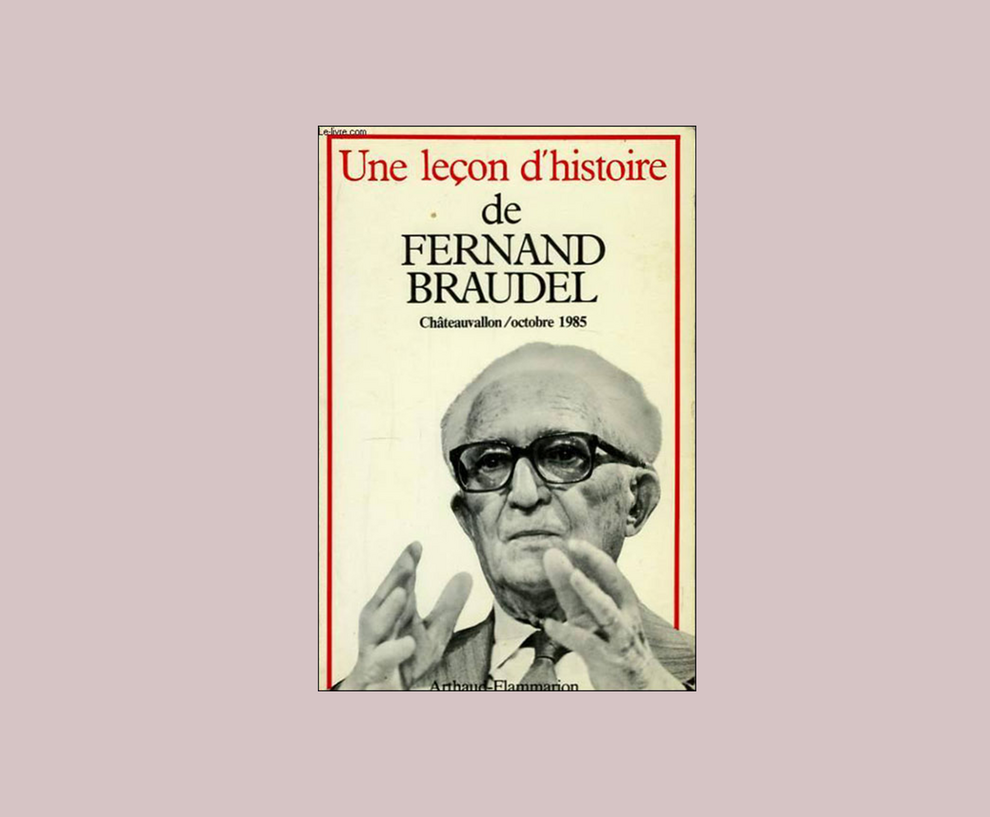
Une leçon d'histoire
Actes du colloque de Châteauvallon, 1985
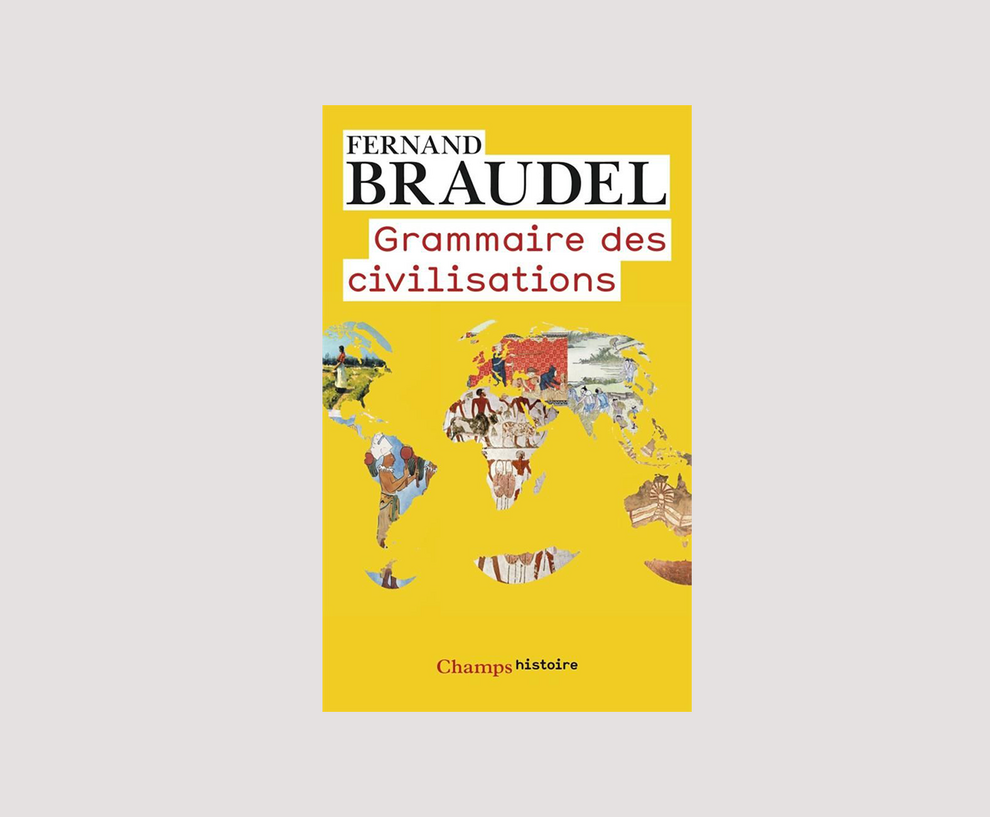
Grammaire des civilisations
Paris, Arthaud, 1987
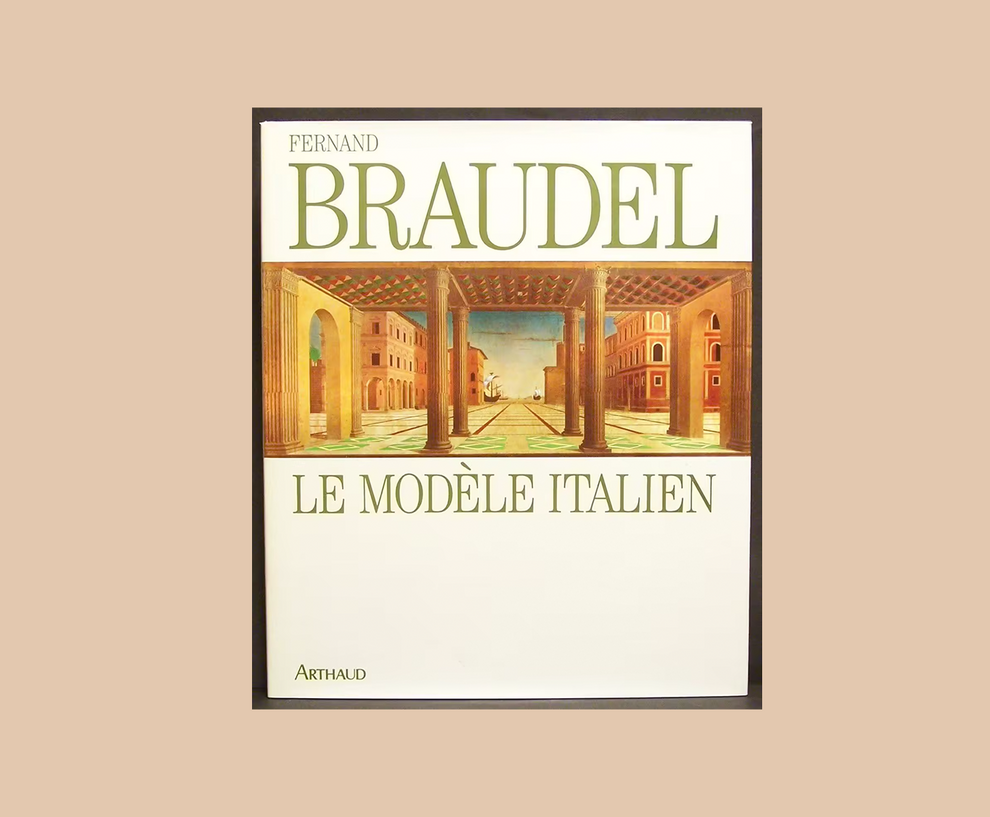
Le modèle italien
Paris, Arthaud, 1989