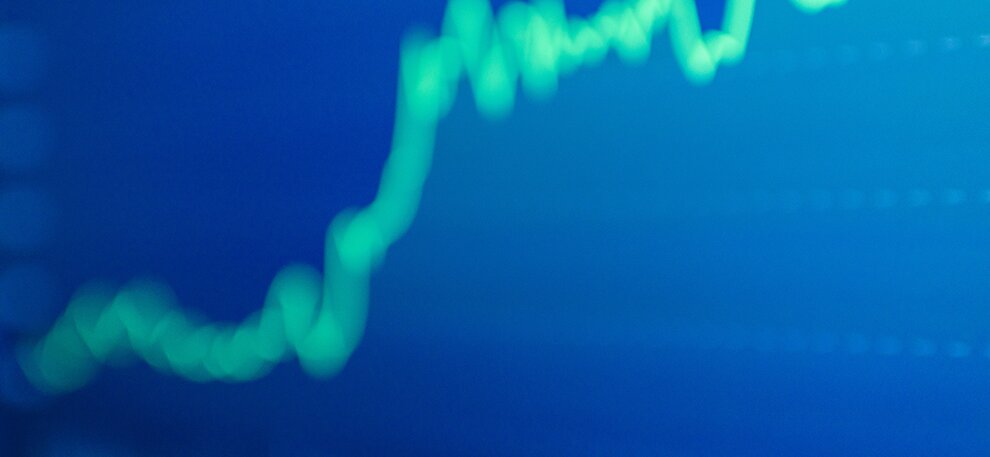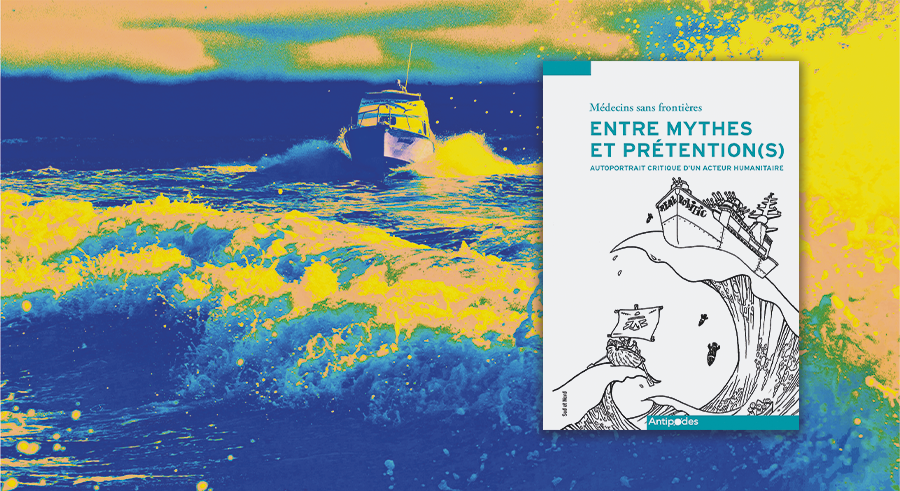La démotorisation des ménages : renoncement ou renouvellement des formes de l’attachement à la voiture ? Regards par les modalités de la socialisation automobile
Séminaire du GRETS - Mardi 28 janvier
Tuesday
28
January
2020
9:30 am
9:30 am

Published at 28 January 2020