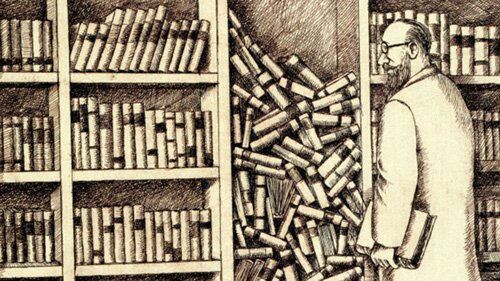Pratiques langagières et organisation sociale diasporique en contexte postcolonial mauricien

Sommes-nous porteurs, sans le savoir, d’un billet de loterie gagnant ? Étudiant à l’Inalco, c’est à l’écriture de mon autobiographie langagière qu’est survenue pour moi la prise de conscience. Par cet exercice, en renouant avec le rompu, en cheminant vers l’éloigné, j’ai été frappé par la richesse culturelle et langagière dont j’étais porteur. Né et ayant grandi en France, avec une ascendance paternelle hakka originaire de l’île Maurice, je n’avais jamais mesuré l’ampleur de cet héritage qui avait laissé place à une nouvelle langue « maternelle » à chaque génération : le hakka, puis le créole, et enfin le français. Pour comprendre ce qui m’avait été transmis (ou ce qui s’était perdu), et en mettant ma démarche au service de la recherche et de l’anthropologie, je suis allé à Maurice, à la rencontre des Sino-Mauriciens, et en particulier des Hakkas.
Minoritaires – représentant moins d’un pourcent de la population mauricienne avec environ une dizaine de milliers de personnes – les Sino-Mauriciennes et les Sino-Mauriciens forment une communauté dont la contribution à l’histoire de Maurice dépasse largement son poids démographique. En 1968, au moment de l’indépendance, les autorités ne s’y trompent pas, et la communauté sino-mauricienne figure encore aujourd’hui parmi les quatre communautés reconnues par la Constitution de la République de Maurice. L’identité hakka et son histoire marquée par l’exil, la contribution au développement économique de Maurice, ou l’apport à la culture mauricienne, pourraient faire l’objet de longs développements. Mais ce qui frappe d’emblée, ce sont les pratiques langagières, et particulièrement la diversité et le mélange des langues. Les pratiques des Hakkas de Maurice sont d’une étonnante richesse : créole, français, anglais, hakka s’enlacent et s’entrelacent, portés par des locuteurs qui les mobilisent avec une aisance telle que leurs frontières en deviennent floues, semblant révéler un langage ouvert faisant feu de tout bois. Une ombre plane néanmoins sur le tableau de cette richesse et créativité langagière : le hakka mauricien semble sur le point de s’éteindre.

Hommage aux ancêtres et prières (Nouvel An lunaire 2021. Pagode Kwan Tee, Les Salines)
Pendant les premières semaines de mon terrain, j’ai eu l’impression d’une langue absente, à peine évoquée, logée dans les souvenirs ou les silences. Puis, au fil des mois, j’ai découvert quelques îlots où elle subsistait. Dans l’intimité d’une pièce discrète, nichée dans une vieille maison sino-mauricienne de Rose Hill, un homme à la modeste carrure transmet, avec patience et dévouement, ses connaissances de la langue et de la culture hakka à quelques apprenants – parmi eux des Sino-Mauriciens désireux de renouer avec la langue de leurs aïeux. Alors même que le mandarin domine aujourd’hui tous les espaces d’apprentissage du chinois, cet atelier existait, à la fois fragile et résistant. Puis, à Port-Louis, dans une salle érigée en l’honneur du Père Paul Wu au cœur des locaux de la Mission catholique chinoise, se tient une messe dominicale en langue hakka et cantonaise. Une vingtaine de doyennes et doyens de la génération née en Chine – parmi les derniers à la représenter – se retrouvent chaque semaine faisant vivre le hakka mauricien dans la foi chrétienne et la solidarité générationnelle. La fin de mon séjour a été marquée par le décès de l’un de ces doyens à l’âge de 94 ans. Pendant plus de soixante-dix ans, il a accompagné l’apostolat de la Mission et a animé les chorales, faisant résonner la langue hakka à travers l’île. Une page s’est tournée. Ces scènes, semblables à des braises encore chaudes dans les cendres d’un feu ancien, ne sont pas des survivances nostalgiques : elles incarnent une tension entre perte et recomposition. Si la langue a pu être sacrifiée – au nom de l’intégration, de l’éducation, du progrès – elle continue pourtant de vivre, parfois à bas bruit, dans les interstices. Car, malgré les ruptures géographiques, générationnelles, langagières, il subsiste des signes, ténus mais tenaces. C’est la plus jeune génération qui me l’a soufflé. Les petits-enfants – parfois devenus canadiens, australiens, anglais, français, etc. – continuent d’appeler leurs grands-parents « kongkong » et « popo ». C’est ainsi qu’on les nomme, je le sais maintenant.

Hommage aux ancêtres de la Toussaint devant des sépultures sino-chrétiennes (01/11/23. Cimetière de l’Ouest, Les Salines)
La disparition d’une langue ne paraît jamais totale, pas plus que son maintien n’est garanti. Elle se réinvente, elle se niche dans des interstices, elle s’accroche à des rites, à des lieux, à des initiatives individuelles et collectives. L’histoire des Hakkas de Maurice raconte quelque chose de plus grand que leur seule communauté. Elle parle de toutes les diasporas, de toutes les langues en suspens, de toutes les identités en recomposition. Elle nous rappelle que l’exil, s’il est souvent synonyme de perte, est aussi une promesse de renouveau. Car les hommes en mouvement ne se contentent pas d’abandonner ce qu’ils laissent derrière eux : ils transforment, ils réinventent, ils recomposent. Ils nous rappellent, en somme, que l’humanité elle-même est une histoire de migrations.

Mauricien.ne.s de tous horizons allumant encens et bougies (nouvel an lunaire 2021. Pagode Kwan Tee, Les Salines)
Anthropologue français spécialiste de l’Inde, Louis Dumont a renouvelé notre regard sur le monde moderne occidental. Son œuvre a mobilisé histoire sociale, sociologie, philosophie, droit et sciences politiques pour penser la genèse et le développement de la modernité. Avec son épouse, Suzanne Tardieu-Dumont, il a créé en 1988 le fonds Louis Dumont, qui offre chaque année une aide ponctuelle consacrée exclusivement à des projets d’enquête de terrain.
Le soutien du Fonds m’a offert une liberté précieuse pour mon enquête ethnographique, et j’en suis profondément reconnaissant. Et plus encore, l’honneur de porter – à mon échelle – l’héritage de M. et Mme Dumont demeure pour moi une source durable d’inspiration et de motivation.

David Low
Article paru dans le troisième numéro du Journal de la FMSH.



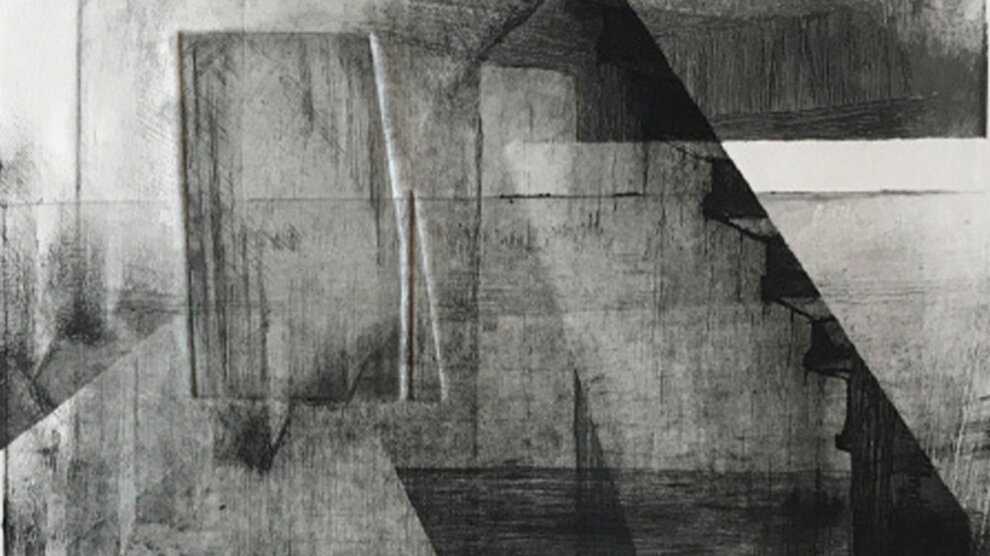
Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité