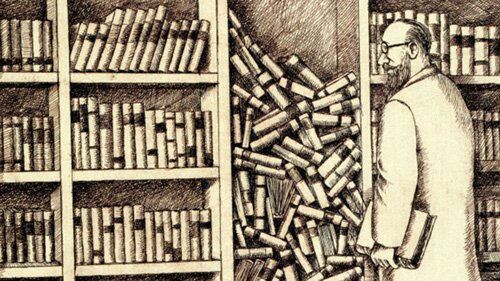La démarche créative des écrivaines plurilingues et des traductrices

Pourquoi et comment ce projet est-il né ?
Ce projet de collaboration internationale fait suite au projet que nous avons développé pendant deux ans au sein de mon équipe de recherche, « Multilinguisme, traduction, création » de l’ITEM (UMR 8132 CNRS/ENS)1. Depuis sa création en 2012, l’équipe étudie le processus créatif des écrivains plurilingues et des traducteurs. Forts de cette expérience, nous avons souhaité explorer une nouvelle problématique, jusqu’alors très peu ou pas du tout étudiée, à savoir la « démarche créative » des écrivaines plurilingues et des traductrices. Si plusieurs membres de l’équipe s’intéressaient déjà, de manière individuelle et indépendante, aux corpus féminins, nous n’avions pas, jusqu’alors, focalisé notre attention sur les particularités de la création « au féminin », ni n’avions engagé de démarche collective dans ce domaine de recherche spécifique. Il s’agissait donc d’unir nos efforts afin de rendre visibles ces créatrices confinées dans le statut des « auteures "mineur(e)s", "périphériques" ou encore "marginales" ». Quant au processus créatif des femmes traductrices, ce champ de recherche reste, lui aussi, assez peu exploré, alors même que les femmes constituent 70 % des personnes qui exercent le métier de traducteur. Dans les deux cas, il s’agit de rendre « visibles » celles dont le travail reste souvent, encore aujourd’hui, « invisible ».
Au bout de deux ans d’études, le temps est venu d’élargir le champ linguistique et géographique aux nouveaux corpus. Nous avons donc eu la chance de donner à ce projet, né initialement au sein d’une équipe, un deuxième souffle, en associant dans le cadre d’un programme tripartite franco-nordique les collègues de l’université d’Oslo et de l’université de Stockholm. La synergie créée entre les trois équipes permettra de mettre encore plus en lumière cette thématique dans l’espoir qu’elle franchira les frontières du monde académique et sensibilisera le grand public sur le rôle des femmes dans la création. En effet, les collègues des deux universités nordiques apporteront une importante contribution en introduisant de nouveaux corpus (à savoir les écrivaines et les traductrices des pays du Nord et des pays de l’Est) qui, pour un certain nombre d’entre elles, n’ont jamais été explorées dans la perspective plurilingue.
Comment allez-vous étudier le processus créatif de ces femmes ?
La méthodologie qui permettra de saisir les secrets de la création constitue un point essentiel. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la « critique génétique », développée par l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM), laboratoire mixte du CNRS/ENS. Cette méthodologie permet d’étudier le processus créatif à travers les documents de travail d’un créateur (brouillons, notes, scénarios, correspondance, etc.), en clair, à travers les documents d’archives qui gardent les traces du processus créatif. En effet, les brouillons d’une œuvre écrite ou d’une traduction offrent cette remarquable possibilité de pouvoir identifier les traces du processus de création. Pour les écrivains plurilingues, les documents de travail permettent, par exemple, d’identifier l’impact de différentes langues qu’elles maîtrisent sur l’élaboration d’une œuvre qui, la plupart du temps, sera publiée dans une langue nationale. Or, en étudiant les archives des écrivains, on constate souvent que sous une langue nationale, langue de la publication de leurs œuvres, se cache souvent le bilinguisme, voire le plurilinguisme. Quand on travaille sur les fonds d’archives, il ne s’agit pas de suppositions : l’approche génétique offre une démarche scientifique rigoureuse qui étudie des traces scripturaires empiriquement observables.
Les brouillons d'une œuvre écrite ou d'une traduction offrent cette remarquable possibilité de pouvoir identifier les traces du processus de création.
Quant au travail des traductrices, les documents d’archives peuvent révéler, par exemple, la véritable identité d’une personne qui a traduit une œuvre littéraire car cette identité peut être occultée ou altérée intentionnellement. Les documents d’archives constituent un véritable contre-poids au paratexte éditorial qui, parfois, reste flou, imprécis, voire erroné. Ainsi, les œuvres autotraduites des autrices bilingues, comme Anne Weber, sont souvent présentées comme originales par les deux champs éditoriaux (français et allemand), alors même qu’il s’agit nécessairement, dans l’un des deux cas, d’une « traduction » auctoriale d’une œuvre déjà existante dans une autre langue. Le seul moyen de connaître le véritable processus créatif est donc d’explorer les archives (quand elles existent) car les brouillons ne mentent jamais.
Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de travailler sur ces supports, je souhaite rappeler que la recherche dans les archives est particulièrement chronophage et exigeante : il s’agit d’un véritable sacerdoce scientifique ! En revanche, elle est souvent récompensée par de merveilleuses découvertes qui font avancer la recherche scientifique et la compréhension des phénomènes.
Comment le rôle des écrivaines et traductrices a-t-il évolué entre le XIXe et le XXe siècle ?
De manière générale, si l’on observe la présence des œuvres/fonds des artistes-femmes dans les collections et dans les archives privées et publiques, on note qu’elle est très limitée en ce qui concerne le XIXe siècle et commence à augmenter lentement au XXe. Le temps est venu, à présent, de mettre en lumière ces femmes, longtemps oubliées et invisibles.
Le XXIe siècle constituera, donc, très certainement, un tournant décisif dans ce domaine. À titre d’exemple, encore au XXe siècle, le nom des traducteurs et, surtout, des traductrices des œuvres littéraires pouvait, tout simplement, ne pas être mentionné sur la couverture ou dans l’appareillage paratextuel, chose qui semble inconcevable et inadmissible aujourd’hui.
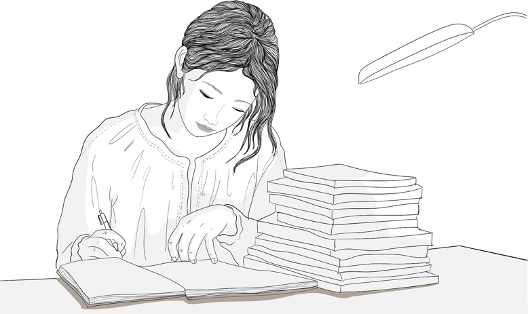
La deuxième moitié du XXe siècle et le XXIe siècle bien entamé ont donné naissance aux nombreuses écrivaines qui soit écrivent en plusieurs langues, soit ont choisi une langue non maternelle pour leur création. Il existe une possible tendance, qui devrait être confirmée par de plus amples études : si, auparavant, les auteurs et les autrices plurilingues cherchaient à correspondre parfaitement au canon littéraire national, les écrivaines du XXIe siècle ne cachent plus leur identité plurielle, que cela soit sur le plan de leur origine personnelle ou de leur expression linguistique. Dans ce dernier cas, elles laissent apparaître dans une œuvre, publiée en langue nationale, les marques de leur langue maternelle, comme c’est le cas, par exemple, de la langue russe qui transparaît en filigrane dans le roman Tenir sa langue (2022) de Polina Panassenko.
La place des autrices et traductrices au sein des sociétés a-t-elle été différente selon les pays qui font l’objet de votre étude ?
« L’invisibilité » est très certainement un point commun aux écrivaines plurilingues et traductrices, quels que soient leur pays d’appartenance et leur langue d’expression. Plusieurs écrivaines plurilingues, étudiées dans le cadre du projet, ont également en commun d’avoir eu une intense activité de traduction, devenant ainsi médiatrices entre les langues et ambassadrices des cultures. Elles ont également souvent contribué, par leurs écrits et par leurs contacts personnels, au développement des réseaux intellectuels et culturels entre différents pays. Par conséquent, leur rôle, la plupart du temps méconnu, dans la circulation des idées et des textes est absolument fondamental. Si vous le permettez, je vais saisir votre question par un autre bout et mentionner quelques pays qui s’intéressent tout particulièrement à l’écriture et à la traduction au féminin. Dans le récent regain d’intérêt, dans le monde de la recherche, pour la créativité des femmes, on peut en effet distinguer quelques initiatives et avancées internationales. On peut citer, par exemple, cinq volumes de The History of Nordic Women’s Literature, qui ont donné lieu également à la création d’une plateforme numérique homonyme2, ou encore le programme de recherche remarquable de l’université de Luxembourg qui a porté, pendant quelques années, sur Les autrices francophones du Grand-Duché de Luxembourg comme précurseures littéraires (1900-2020)3.
Leur rôle, la plupart du temps méconnu, dans la circulation des idées et des textes est absolument fondamental.
On peut également penser à une autre initiative récente, la création d’un portail digital LEDL-Letteratura delle italiane qui recense, à travers des fiches biographiques, critiques et bibliographiques, les autrices italiennes de différentes époques4. Enfin, la recherche sur les femmes et leurs archives prend toujours plus d’ampleur de l’autre côté de l’Atlantique – au Brésil –, qui multiplie les initiatives collectives dans le domaine de la recherche sur la création des femmes. Je pense notamment à la Cartographie des archives féminines5 ou encore à la création d’un important Réseau de chercheurs sur les archives des femmes6. Toutes ces initiatives, auxquelles nous souhaitons aussi contribuer à travers notre projet franco-nordique, auront pour conséquence la sensibilisation du public et des institutions à l’importance de la recherche sur les femmes créatrices et à la sauvegarde et l’exploration de leurs archives.
Quelles sont les actions prévues dans le cadre de ce projet et ensuite ?
Le travail sur les corpus des femmes, qui relèvent de différentes aires linguistiques et géographiques, est rythmé par les rencontres scientifiques. La première en date a été le colloque international L’étude du processus créatif des écrivaines francophones plurilingues aux XXe et XXIe siècles qui s’est tenu en juin 2025 à l’Académie royale suédoise des belles-lettres, d’histoire et des antiquités-KVHAA (Stockholm). Cette manifestation, qui a réuni les chercheurs de plusieurs pays, a révélé les secrets du processus créatif chez les écrivaines plurilingues aux xxe et xxie siècles. Cela a été l’occasion d’analyser les différentes modalités créatives des autrices qui ont choisi le français comme langue d’expression : l’écriture en plusieurs langues ou dans une langue non maternelle, l’autotraduction, la traduction collaborative voire la traduction. En effet, toutes ces activités sont fortement imbriquées et doivent être appréhendées dans une vision globale. D’autres rencontres seront programmées à Paris et à Oslo afin de continuer à explorer des corpus féminins toujours plus nombreux. Enfin, nous espérons que ce projet de deux ans pourra déboucher sur un programme de recherche plus large. En effet, une association avec d’autres institutions et d’autres chercheurs étrangers qui s’intéressent à cet objet d’étude contribuerait à constituer et à renforcer ce champ de recherche. « Écrire et traduire au féminin », ce sujet mérite une forte mobilisation de ressources humaines et financières pour créer un programme international d’une envergure et d’une portée temporelle, géographique et linguistique plus large.
1. L’équipe a pour objectif l’étude du processus créatif des écrivains plurilingues et des traducteurs : http://www.item.ens.fr/multilinguisme/
2. https://nordicwomensliterature.net/welcome-to-the-history-of-nordic-womens-literature/
3. https://feather.hypotheses.org/
4. https://letteraturadelleitaliane.it/
5. https://sites.google.com/view/mapatrama/mapa
6. https://redearquivosdemulh.wixsite.com/website-2
Projet lauréat 2024 du programme franco-nordique
Article paru dans le troisième numéro du Journal de la FMSH.



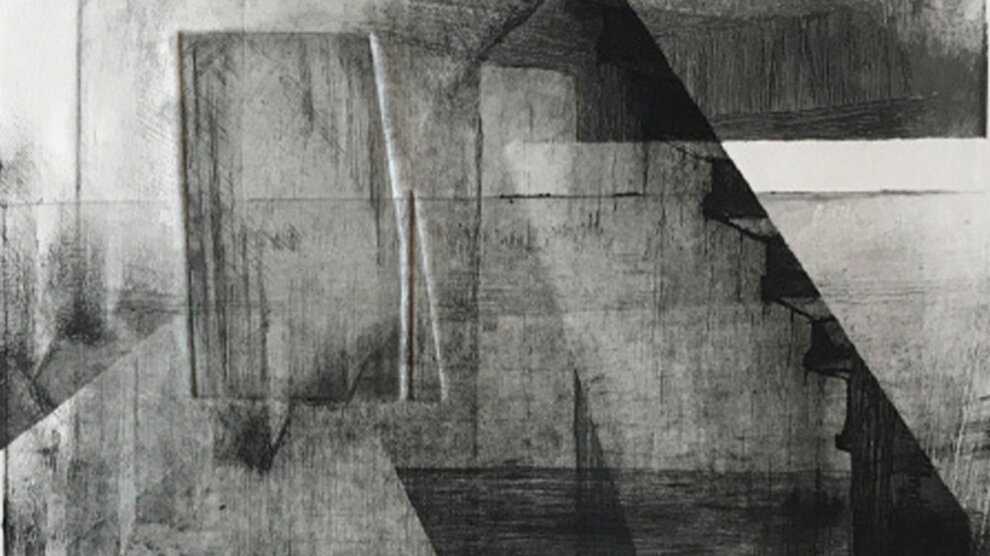
Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité