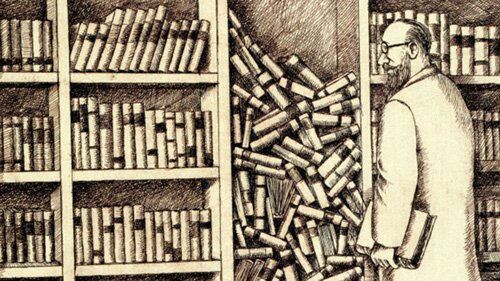Au-delà de l'anthropocène : repenser la ville par le prisme des théories urbaines critiques

Alors que la planète se réchauffe de plus en plus et que l’urbanisation mondiale s’intensifie massivement, il est urgent de repenser ce qu’est la ville, ce qu’elle peut être et comment elle peut être conceptualisée de manière à permettre à l’humanité de survivre à l’Anthropocène et d’entrer dans un avenir post-Anthropocène. Cette étude traite la double crise planétaire du changement climatique et de l’urbanisation à travers un dialogue critique multiformat entre les courants de pensée urbaine dans le contexte franco-nordique. L’objectif central de ce projet est d’établir une conjonction de courants de pensées dynamiques. Plus précisément, le projet pose la question suivante : quels modèles théoriques peuvent être mobilisés dans la construction d’une approche critique de la ville et, plus précisément, d’une discussion post-Anthropocène en devenir ? Notre approche consisterait à cartographier et à étudier dans quelle mesure le social et le spatial sont associés ou entrent en dissonance à différentes échelles urbaines.
Cette étude traite la double crise planétaire du changement climatique et de l’urbanisation à travers un dialogue critique multiformat entre les courants de pensée urbaine dans le contexte franco-nordique.
Dans cette perspective, il convient de questionner les objets, les formes et les modes d’appropriation de la ville existante. Nous étudierons aussi la ville future, c’est-à-dire ce que l’urbain va devenir, en répertoriant et étudiant ce qui est susceptible d’être approprié par les acteurs, indépendamment de la nature ou de la configuration spatiale dans laquelle les modes d’appropriation de la ville sont mis en œuvre. Dans cette approche, la ville peut être considérée comme le support tangible d’une transformation continue où se déploie « une mise en intrigue du monde social1 ». Nous aborderons aussi la ville dans sa forme discrète, et de manière moins évidente, car le chercheur urbain peut être confronté à la présence de travaux de terrain ambigus et ambivalents : « il y a des devenirs qui opèrent dans le silence, qui sont presque imperceptibles2 ». Cette double focalisation, sur le tangible et le visible et sur le « presque imperceptible » permet une approche globale de l’urbain et se prête à des rapprochements et à des comparaisons. Cela nous ramène à la question de la temporalité, c’est-à-dire au temps de l’urbain et à ce qui se révèle au moment même où l’urbain et ses espaces sont en train de se faire. Une manière de détecter ces futures villes possibles – « la ville à venir3 » – est de transposer à la ville la méthode indiciaire des microhistoriens, notamment celle de Carlo Ginzburg4, en recherchant des indices dans une articulation entre le social et l’espace.
Interroger cette ville en devenir, c’est dépasser la généalogie de la pensée urbaine critique existante pour tenter de la reconfigurer à la lumière de travaux plus récents dans le contexte nordique5. Les périodes de crise et de troubles créent des formes de dislocation, de dépossession et de fragmentation de la ville. Les défis auxquels est confrontée la configuration urbaine dans les pays nordiques, en France et dans le monde extraeuropéen sont en effet complexes et effrayants, notamment parce qu’ils sont propulsés par le changement climatique anthropocène et, souvent, par des formes urbaines de politique orientées vers la fragmentation, la marchandisation et le consumérisme. Sans ignorer ces défis, l’approche méthodologique que nous proposons nous amènerait à trouver ce qui relie les acteurs de l’espace urbain, à travers un récit commun dans lequel ils se reconnaissent. Ces discours où les temporalités – mais aussi les représentations – de la ville confluent de diverses manières étayent à la fois les actions dans les territoires (urbains) que nous identifierons, ainsi que notre évaluation des formes durables de résonances, d’échanges d’idées et d’inspiration qui se sont développées à travers les espaces de la France et des pays nordiques.
1. VEYNE Paul.
2. DELEUZE Gilles et PARNET Claire, Dialogues, Paris, Flammarion, 1996.
3. SIMONE AbdouMaliq, For the City Yet to Come, Berkeley, Duke University Press, 2004.
4. GINZBURG Carlo, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989.
5. Voir les travaux de Bjørn Bertelsen et Morten Nielsen ou ceux de Thomas Hylland Eriksen, qui examinent les tensions à l’œuvre dans la ville contemporaine.
Article paru dans le deuxième numéro du Journal de la FMSH.


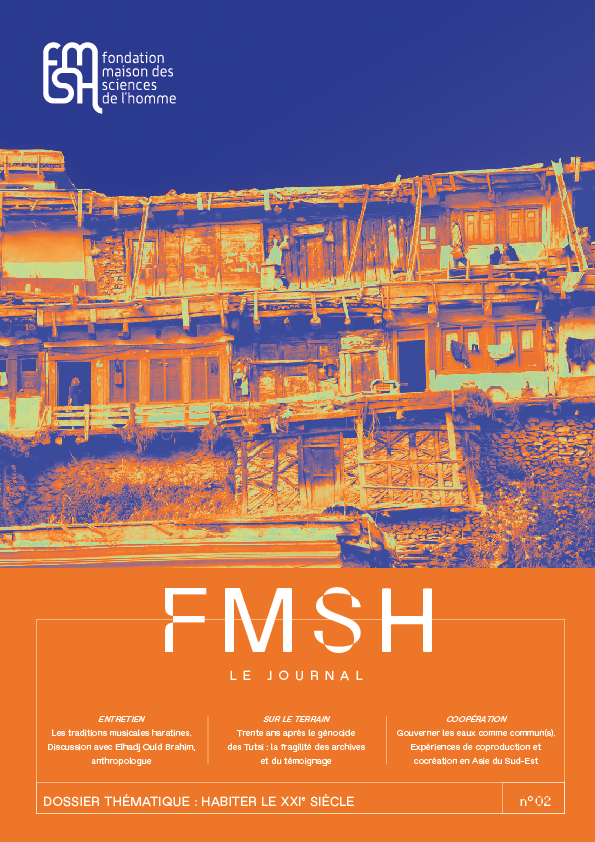
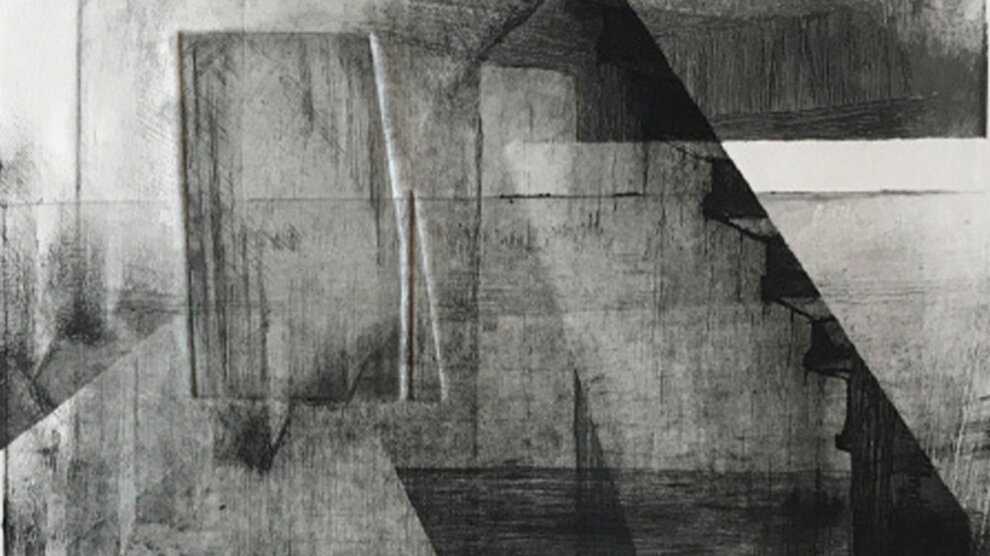
Le coopérisme

De la rue à la mairie

Maternités autorisées, maternités proscrites