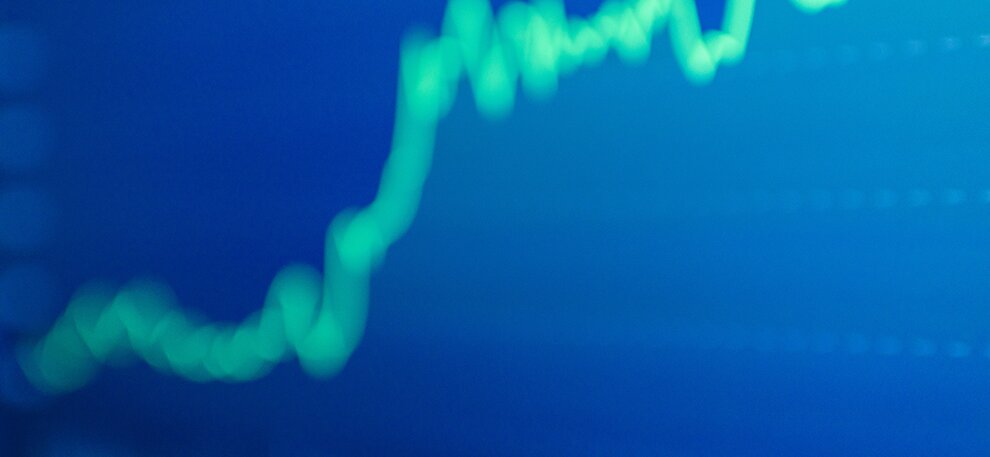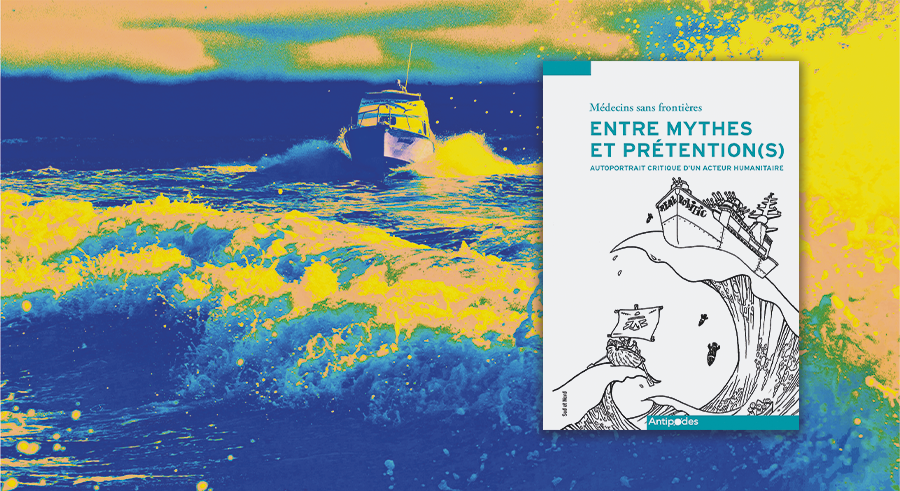Refuser l'intersectionnalité : Les cas de violence sexuelle et sexiste dans les établissements universitaires
12 décembre | Séminaire de Shivani Gupta
Jeudi
12
décembre
2024
18:00
19:30
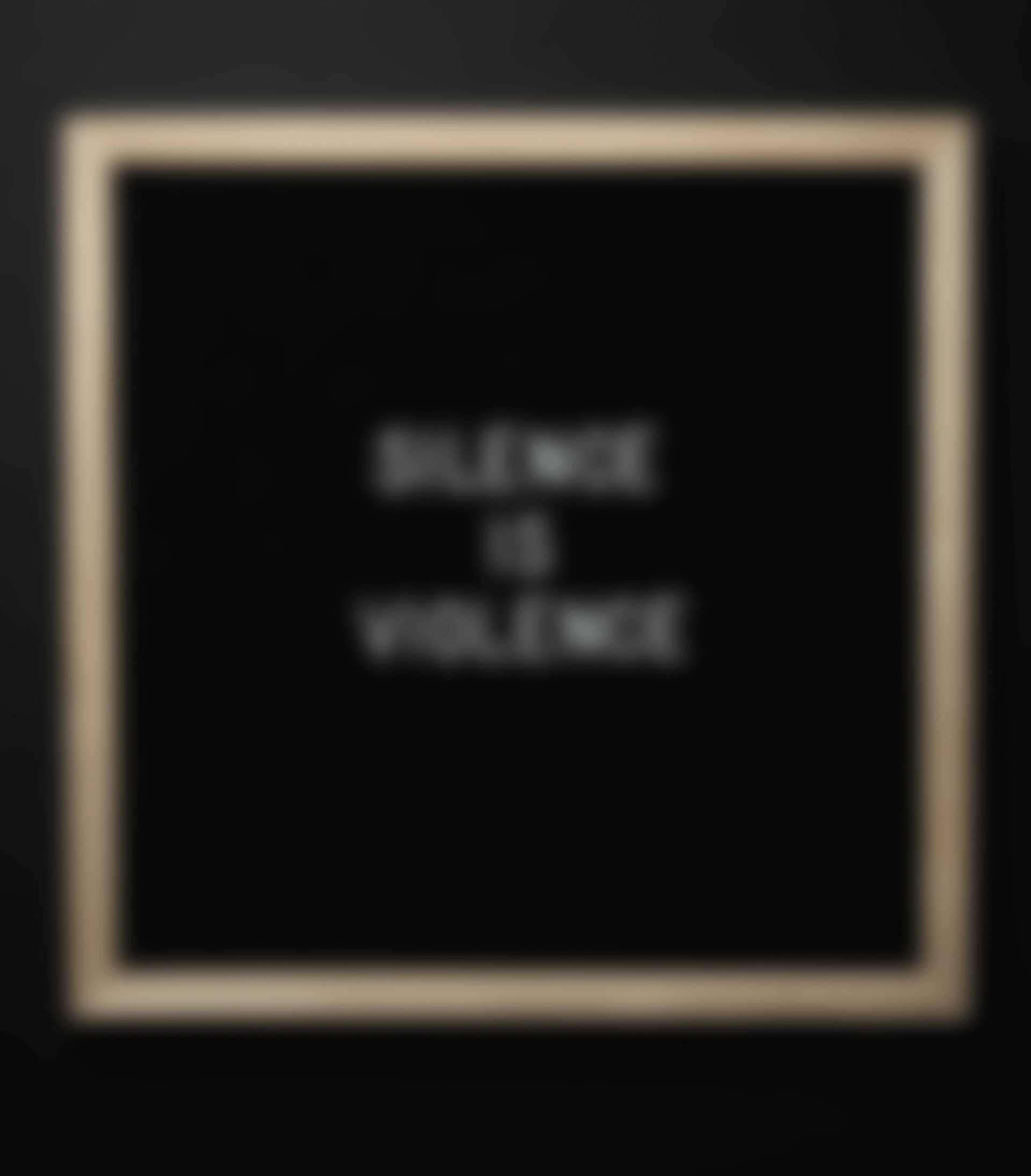
Présentation d'une recherche en cours dans le cadre des "Jeudis de la Maison Suger", séminaire de recherche des résidents. *Séminaire en anglais*
Publié le 12 décembre 2024