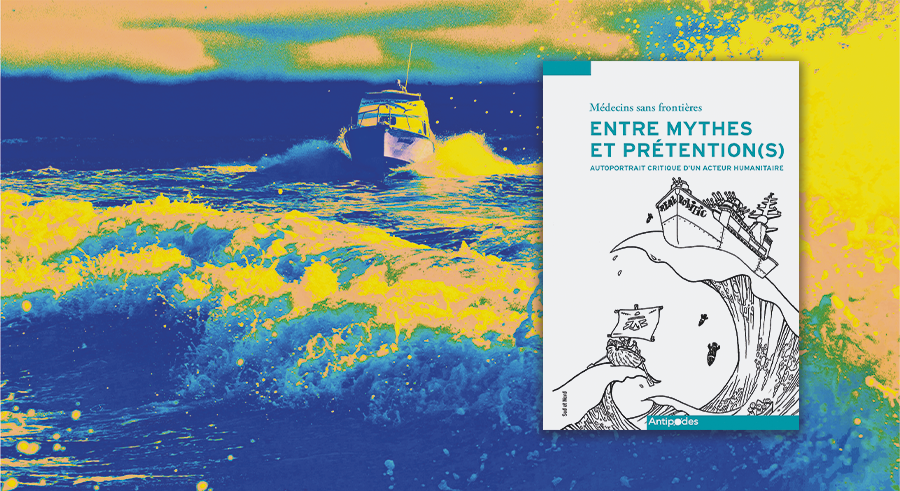Le corps et le psychisme

À partir des années 1950, la production de médicaments efficaces pour le traitement des délires, et plus récemment de la dépression et de l'anxiété, a ouvert la psychiatrie à d'autres domaines de la compréhension du psychisme humain, en particulier la psychanalyse et la philosophie. Cependant, les éditions successives du DSM ont répandu la notion de désordre qui diffère de la conception analytique du fonctionnement psychique et de sa dimension subjective. En s'éloignant des considérations phénoménologiques et psychodynamiques, en restreignant la construction des diagnostics aux descriptions comportementales, le spectre de la pathologie mentale semble englober un nombre croissant d'individus, laissant peu de place à la notion d'une vie normale comportant des oscillations, des hauts et des bas, et les différences liées au caractère unique de certains individus. Quand nous pensons à la normalité comme un exercice continu de normativité, c'est le rapport même entre santé et maladie qui change, puisque ces termes s'opposent sans équivoque. De ce point de vue, être en bonne santé n'est pas la même chose que ne pas avoir de maladies - c'est au contraire être capable de tomber malade et de se rétablir. Il s'agit d'être normatif. La pathologie est inscrite comme faisant partie de la vie et, en ce sens, une vie totalement immunisée contre le pathos n'est qu'une abstraction.
Dans ce cadre nous nuançons la naissance de la pensée psychanalytique à partir de Freud dont la sexualité est la base et le paradigme du psychisme humain y compris dans la production des symptômes et des pathologies mentales. Plus encore que des techniques thérapeutiques, la psychanalyse propose à la psychiatrie et à l’ensemble des savoirs de la santé mentale une certaine intelligence de l’humain et de relation interhumaine dont la possibilité d’établir un dialogue avec la philosophie.
En dépit de l’éloignement que les singularisent et leurs origines, philosophie et psychanalyse se rapprochent. Il y a aujourd’hui des philosophes qui s’intéressent à la psychanalyse, soit intrinsèquement soit comme matière à réflexion, soit comme méthode. Et il y a des psychanalystes qui s’intéressent à la philosophie, voire qui lui font appel, dans les formes et les développements qui leur paraissent les plus propres à éclairer leurs problèmes. Ce rapprochement, en dehors des causes sociales et matérielles qui le rendent possible telles que l’accroissement de la littérature analytique et la multiplication des contacts, a des causes profondes dans l’histoire des idées. Ainsi il y a dans les catégories mêmes de la pensée moderne quelque chose qui incite le philosophe et le psychanalyste à ne pas rester étrangers l’un à l’autre.
Nous interrogeons les rapports et les frontières entre la psychanalyse et la philosophie à partir du corps et de la santé mentale puisque la vie psychique n’est pas désincarnée. Selon Freud , le Moi est avant tout corporel ; les perceptions sont liées aux pulsions et à la représentation que nous avons de notre corps. L’appropriation française de la pensée germanique à partir de la phénoménologie porte un dialogue avec la pensée psychanalytique (Politzer, Sartre, Paul Ricœur, Merleau-Ponty, Descolas). Dans le domaine de la Psychanalyse française nous pouvons nommer Ajuriaguerra, Gisela Pankow, André Green et d’autres dont le travail dialogue avec la phénoménologie, la notion du corps propre et la notion de la chair propre à Merleau-Ponty.
Réunir des psychanalystes et des philosophes dans un dialogue sur la corporéité et la santé mentale contribuera à élargir les deux domaines en permettant la rencontre entre la logique de la conscience et la logique de l'inconscient dans une perspective de complexité et d'écoute.
Matin
9h - Ouverture
Mot de bienvenu par les représentants de la Maison Suger et de la FMSH
Introduction à la journée d’étude par Petrucia Nóbrega
9h30
Clarisse Baruch (CEJK/ASM13) - « Se reconnaitre : l’identité, entre corps et psyché »
10h
Vassilis Kapsambelis (CEJK/ ASM13) - « La pulsion, une promesse non tenue du lien corps-psychisme ? »
Modération – Carlos Parada (EMP Fontenay sous Bois)
10h30-11h
Discussion
11h15
Walter Ribour (CEJK, AEPPC) - « Penser le corps avec la Psychothérapie Psychanalytique Corporelle
11h45
Sylvie Reignier (SPP, AEPPC) - « Le corps comme un orchestre »
Modération - Selma Lancman (Université de São Paulo)
12h15-12h45
Discussion
Après-midi
14h30
Sara Guindani (CRMPS, Université Paris Cité) - « ‘Cette contradiction si étrange de la survivance et du néant entrecroisés en moi’ : corps, mémoire et écriture chez Proust »
15h
Philippe Cabestan (École Française de Daseinsanalyse) - « Corps phénoménal et psychiatrie »
Modération : Sabine Sportouch (CRMPS, Université Paris Cité)
15h30-16h
Discussion
16h10
Diran Donabedian (IPSO) - « Le corps, la pensée et le soma: à propos de l'approche psychosomatique »
Modération : Katia Brasil (Université de Brasília)
16h40-17h10
Discussion
17h15
Alain Gibeault (CEJK, ASM13) - « Théorie de la connaissance et théorie du fonctionnement mental: Réflexions sur la fécondation réciproque entre philosophie et psychanalyse »
17h45
Claude Imbert (ENS) - « Le corps est un complice »
Modération : Petrucia Nóbrega (UFRN, CNPq Brésil)
18h15 - 19h
Discussion générale et conclusion
La journée d'étude est organisée par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, l'Association Santé Mentale du 13e arrondissement / Centre de Psychanalyse Evelyne et Jean Kestemberg, l'université Fédérale du Rio Grande do Norte et le conseil national pour le développement scientifique et technologique Brésil.

Découvrir la page chercheur de Petrucia Da Nobrega

Projection du film « One by One »
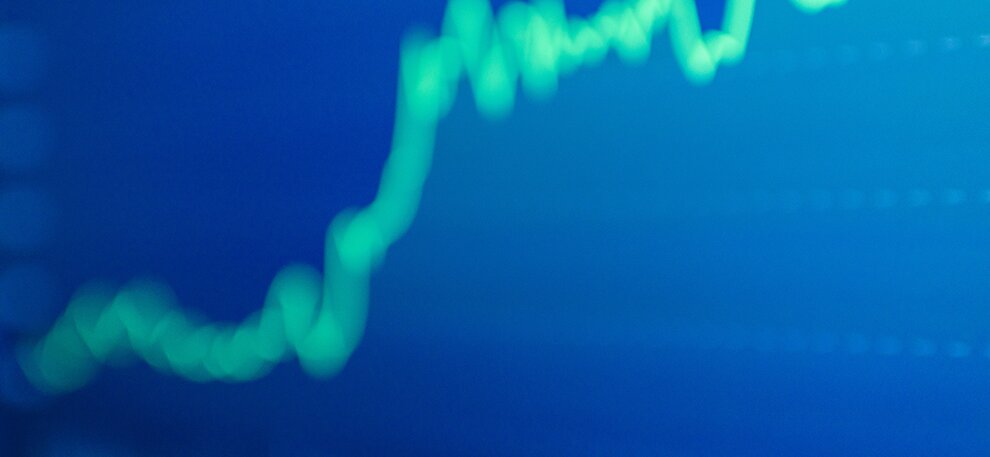
Rapports d’activité des services agricoles versus bulletins économiques des colonies

Les nouvelles lignes de conflit et l'accélération algorithmique