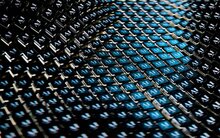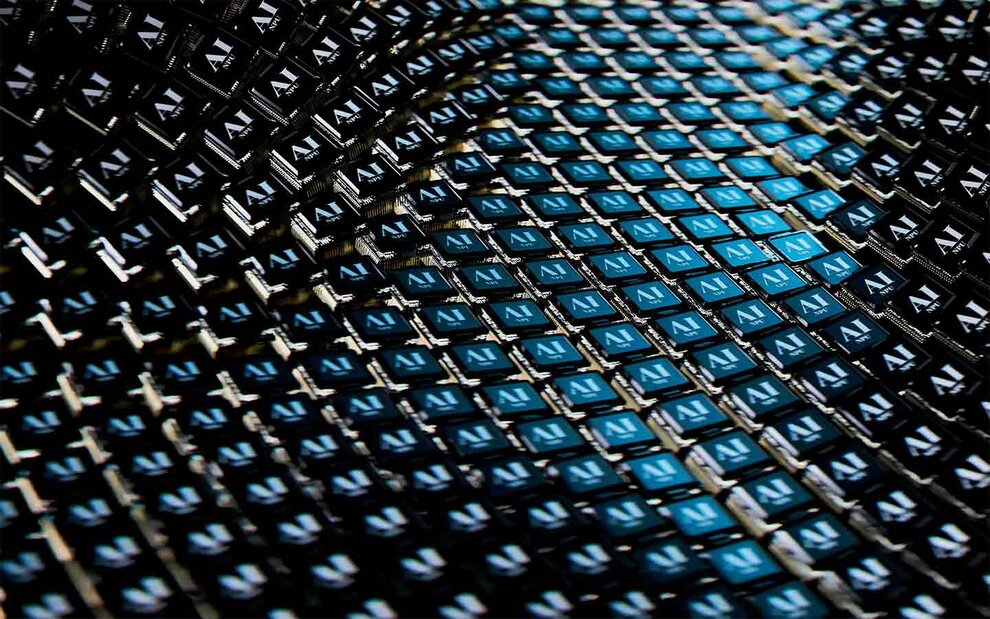Séminaire international de sémiotique à Paris
Programme 2025-2026 | Cycle de séminaires
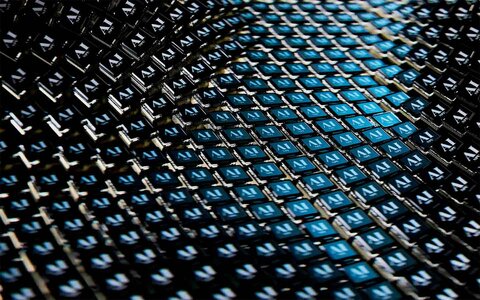

Langage, stéréotypes et intelligence artificielle : vers une nouvelle sémiotique de l’automatisation.
Publié le 19 août 2025