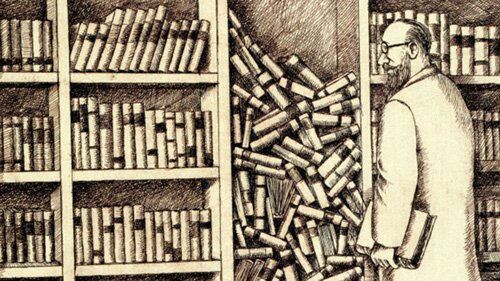Trente ans après le génocide des Tutsi : la fragilité des archives et du témoignage

Dans la continuité de la thèse que j’ai consacrée à la participation des femmes au génocide commis contre les Tutsi du Rwanda, j’ai voulu entamer une recherche sur leur autonomie criminelle. Ce projet, encore en cours, doit me permettre d’affiner mon approche du phénomène génocidaire féminin. Pour le mener, j’ai choisi de me limiter à trois types de crimes plus spécifiquement commis par des femmes et ne relevant pas des mêmes catégories judiciaires : le transport de pierres sur les sites de massacres, le dépouillement des cadavres et enfin l’infanticide.
Entamer de nouvelles enquêtes sur l’infanticide génocidaire répondait à la nécessité de valider les hypothèses développées dans mon ouvrage Tout les oblige à mourir (CNRS Éditions, 2024). J’ai donc démarré une étude sur le plus facile à traiter des quatre nouveaux cas identifiés. La rencontre avec Dancira Nyirarwaya, qui purge une peine de 19 ans de prison pour la mort de ses cinq enfants, m’a confrontée à de nouvelles difficultés, méthodologiques et épistémologiques. En effet, je me suis retrouvée face à un matériau se caractérisant d’abord par les silences et les contradictions. Trente ans après le génocide, et tandis que d’importants efforts ont été engagés par le gouvernement rwandais en faveur de la justice et de l’aveu, certaines histoires conservent leur mystère. Dans le cas présent, une approche conjuguant entretiens et consultation des archives judiciaires gacaca n’a pas encore permis de lever le voile entourant la mort des enfants de Dancira. Ce cas, dont l’étude doit se poursuivre, ouvre la recherche à de passionnantes questions sur le rapport que les chercheurs entretiennent avec leurs sources, et sur la somme d’entraves pesant sur le travail d’objectivation qui est le leur. Compte tenu du comportement réfractaire, voire parfois agressif de Dancira, et compte tenu du soupçon pesant sur la décision du tribunal, il pose aussi la question de la relation s’établissant avec le « sujet "détestable" » – ici pas coopératif –, ainsi qu’avec la vérité judiciaire.






Lorsque le génocide a commencé, en avril 1994, Dancira Nyirarwaya était mariée à un Tutsi qu’elle connaissait depuis l’enfance, né comme elle dans une riche famille paysanne polygame. Le massacre de ses beaux-parents et de son mari l’a poussée à chercher refuge avec ses enfants dans sa famille de naissance, selon elle coupable de la mort de ces derniers. Les archives judiciaires gacaca, qui ont jugé Dancira comme un million environ de présumés génocidaires, la présentent tantôt comme une victime, tantôt comme une coupable. Son procès, qui s’est tenu en son absence et sans témoins, n’a laissé que quelques lignes dans un cahier. Comme son témoignage, délivré avec une très grande réserve, le récit judiciaire est lacunaire. Trente ans après les faits, seule la rencontre de nouveaux acteurs offrira d’éclairer les circonstances dans lesquelles ces cinq enfants nés d’un père tutsi et d’une mère hutu appartenant à la notabilité paysanne ont été tués.
Article paru dans le deuxième numéro du Journal de la FMSH.


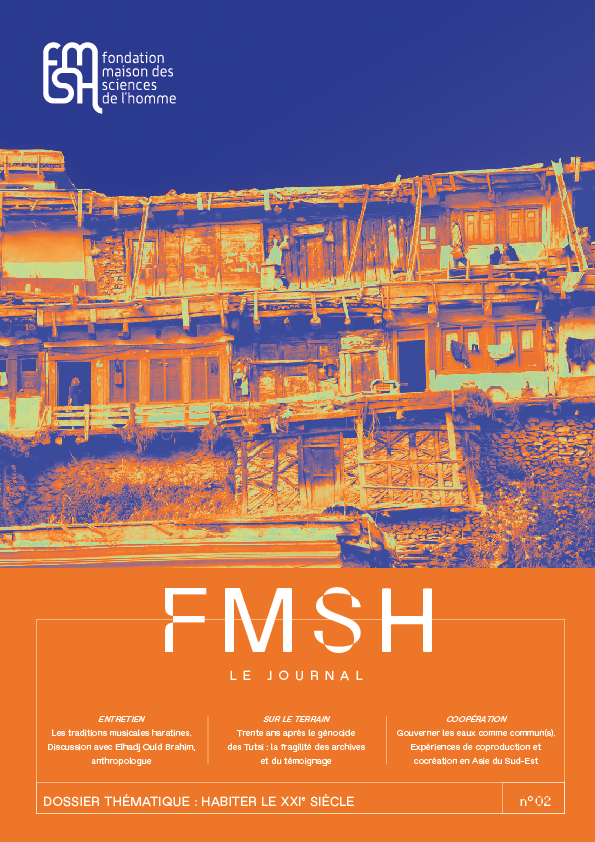
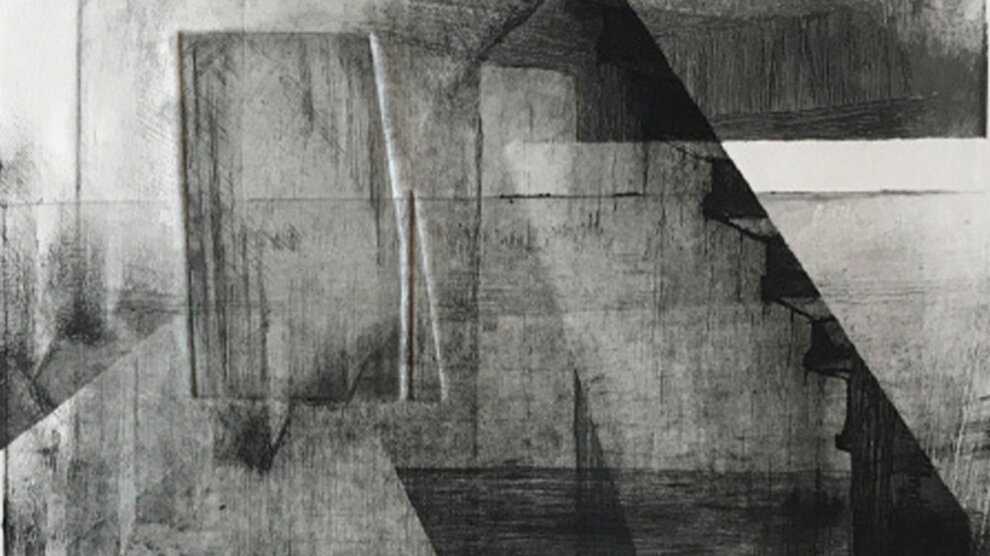
Le coopérisme

De la rue à la mairie

Maternités autorisées, maternités proscrites