L’historicisation de la philosophie après Kant en Allemagne et en France

Cet article qui présente un projet en cours montre comment une histoire de la philosophie de plus en plus autonome et abstraite s’est développée à partir de la fin du XVIIIème siècle en Allemagne et en France. La philosophie se dote d’une histoire pleinement philosophique, mais sans renoncer à sa part empirique. L’historien de la philosophie kantien Tennemann rompt ainsi avec le partage entre les deux domaines de l’histoire empirique et de l’histoire rationnelle opéré par Kant. Mais ce faisant la question se pose de savoir si une histoire qui n’est plus une pure reconstruction rationnelle mais est en partie empirique peut encore conduire à la paix philosophique. C’est le point où Degérando, l’un des premiers historiens de la philosophie en France, se distingue de Tennemann en 1804. Chez les deux auteurs, l’histoire de la philosophie ne se contente pas de mettre en œuvre un jugement historique ayant trait aux systèmes passés, mais déploie aussi une critique philosophique à travers le classement et le récit. Cependant Degérando place une confiance plus grande dans l’histoire de la philosophie du fait d’une philosophie de la connaissance accordant une part plus importante à l’expérience, qu’elle soit sensorielle ou historique.
L'auteur
Agrégée et docteur en philosophie, diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, l’auteur est actuellement A.T.E.R. à l’université de Lorraine. Sa thèse portait sur l’efficace politique attribuée à la philosophie à la fin de la Révolution française, dans un corpus franco-allemand réunissant les Idéologues, le groupe de Coppet, Kant et certains post-kantiens. Il analysait les limites de la philosophie et les médiations par lesquelles on a pensé pouvoir l’inscrire dans les principes de gouvernement et la diffuser indirectement par l’enseignement et les discours publics. Ce travail s’est poursuivi par la publication d’un volume collectif et pluridisciplinaire aux Presses universitaires du Septentrion, consacré à la façon dont les savants, les écrivains et les philosophes ont conçu leur rôle politique en France et en Allemagne, de la mort de Voltaire au Vormärz. Plus récemment, cette réflexion sur l’impureté de la philosophie a trouvé un prolongement dans son travail post-doctoral de traduction et commentaire des Sylves critiques de Herder. Enfin, cette question de l’historicisation de la philosophie l’a amenée au projet de recherche conduit lors d’un séjour de recherche au Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Lumières en Europe (I.Z.E.A.) de l’université Martin Lüther de Halle.
Le texte
Ce texte a été produit dans le cadre d’une bourse Fernand Braudel IFER outgoing, au Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Lumières en Europe (I.Z.E.A.) de l’université Martin Lüther de Halle, entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2014.

Sous les temps de l'équateur. Une histoire ancienne de l'Amazonie centrale
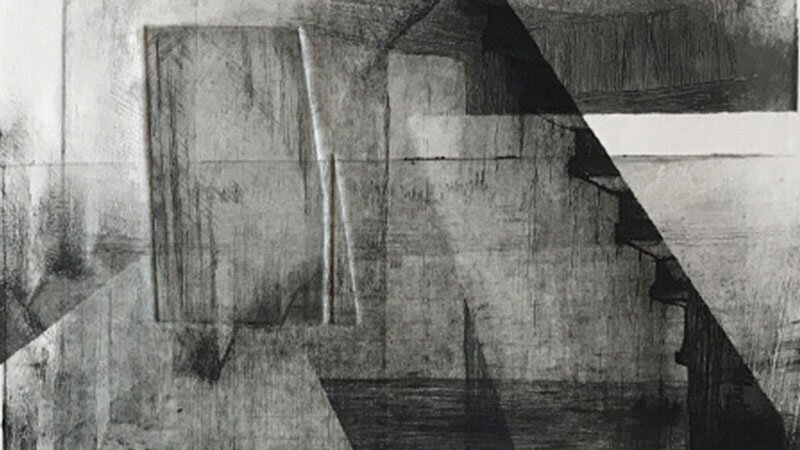
Le coopérisme

De la rue à la mairie


