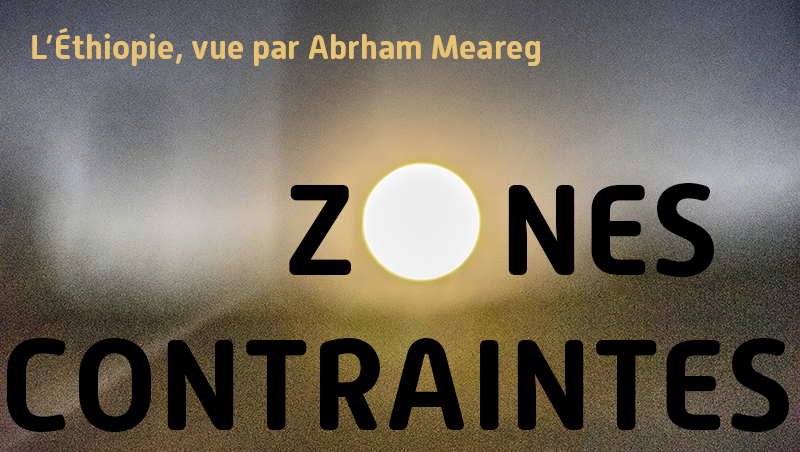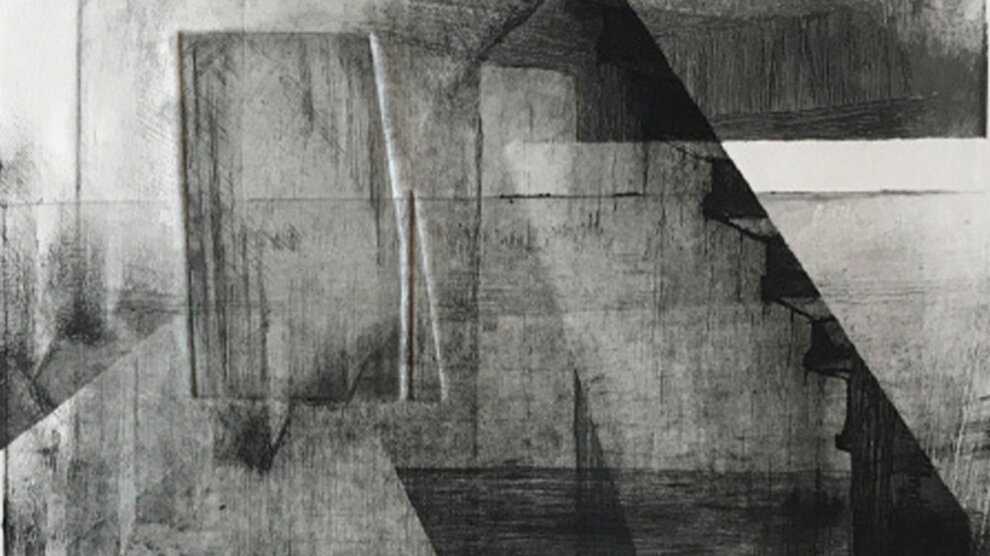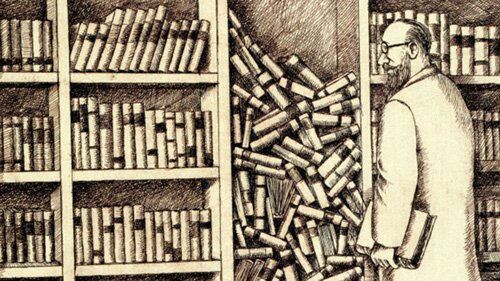En Éthiopie, la recherche face à la guerre
Témoignages de Mehdi Labzaé et Mitiku Gabrehiwot

Deux chercheurs soutenus par la FMSH témoignent sur la guerre civile qui a déchiré l’Éthiopie entre 2020 et 2022, opposant le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple tigréen (TPLF) ainsi que leurs alliés respectifs.
Publié le 10 janvier 2024