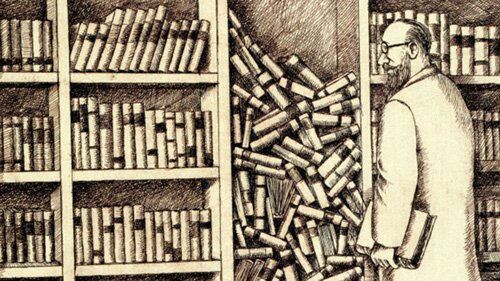Archéologie et paysage

L'entrée dans l’Anthropocène, défini par le fait que l’humanité est devenue une force naturelle capable de déstabiliser le système Terre, remet en question le grand partage entre nature et culture communément admis en Occident. Elle nous invite à réfléchir autrement aux interactions entre les sociétés humaines et leur milieu.
Les Nouvelles de l’archéologie publient une sélection des communications prononcées à Hyères en octobre 2017, lors des rencontres de l’association nationale pour l’archéologie de collectivité territoriale (ANACT). La thématique retenue illustre les préoccupations scientifiques, patrimoniales et sociales que partagent tous les services et musées archéologiques territoriaux. Peut-on conjuguer l’étude et la mise en valeur des patrimoines archéologiques et naturels, selon quelles modalités et avec quels objectifs ?
Alors que l’archéologie précède désormais l’effacement des sites et le bouleversement des paysages, ces patrimoines peuvent-ils faire l’objet de programmes de valorisation communs, accompagnant les prises de conscience environnementales et les défis posés par l’évolution de la société contemporaine ?
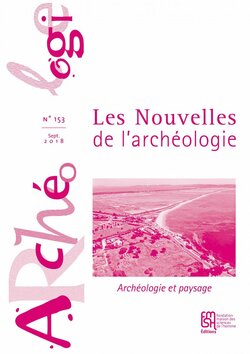
Parution prévue le 21 mars 2019
Édition Première édition
Éditeur Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris
Support Livre broché
Nb de pages 76 p.
ISBN-10 2-7351-2427-4
ISBN-13 2-7351-2427-5
GTIN13 (EAN13) 9782735124275
Sommaire
Éditorial
De la patrimonialisation des paysages à leur mise en tourisme
Laure Koupaliantz, Sites pittoresques et sites patrimoniaux remarquables (Service archéologique de Reims Métropole)
Léa Maroufin, La patrimonialisation de l'oppidum de Gergovie (La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme) : construction symbolique d’un paysage culturel
Mélanie Duval, Ana Brancelj et Christophe Gauchon, Rendre visibles les vestiges archéologiques. Possibilités de valorisation des sites palafittiques préhistoriques alpins
François Carrassan et Carine Deal, Archéologie et paysage à Hyères : deux sites antiques au cœur d’une Opération grand site
L’archéologie des paysages, entre recherche scientifique et développement culturel
Quentin Borderie, Cécile Germain-Vallée, Patrice Wuscher, Teddy Bos, Stéphane Gaillot, Hervé Tronchère et Éric Leroy, Les paysages géo-archéologiques de collectivités : milieux arides ou terres de culture ?
Olivier Brun, Henri-Georges Naton, Caroline Schaal, Guillaume Jamet, Laurent Brou et Foni Le Brun-Ricalens, Archéologie et écologie : le potentiel documentaire des séquences documentaires des plaines alluviales
Stéphane Bonnet, Marc Panneau et Hugues Giroux, La modélisation au service de l’évaluation et de la caractérisation du sol urbain d’Aix-en-Provence
Stéphane Gaillot avec Laurent Strippoli, Hervé Tronchère, Jules Ramona, Nicolas Hirsch, Eric Leroy et Marion Baudrand, Valoriser le patrimoine naturel en ville, une gageure ? Le cas de Lyon
Ivan Lafarge et Caroline Hoerni, Le parc départemental de la Haute-Île : un outil de valorisation des patrimoines naturels et archéologiques, un instrument de recherche et d’observation
Emanuela Rossetti o Roscetti, Cristiana La Serra et Fabio Lico, La città di Ruggero : développement socioculturel et recherche scientifique
Le paysage, une référence identitaire ?
Vincent Hincker et Cécile Germain-Vallée, Dis-moi dans quel paysage j’habite, tu me raconteras son histoire : lorsque l’archéologie contribue à la fabrique des nouvelles identités territoriales
En savoir +
Ivan Lafarge est le coordinateur scientifique de ce numéro.
Il est chercheur associé à l'équipe d’histoire des techniques de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine, université de Paris-I Panthéon-Sorbonne – CNRS, UMR 8066. Département de la Seine-Saint-Denis, service du patrimoine culturel, bureau du patrimoine archéologique.
Depuis 2014, il est chargé de cours « Archéologie des structures techniques ; le bâti » dans le cadre du master d’histoire des techniques du centre d’histoire des techniques de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne.
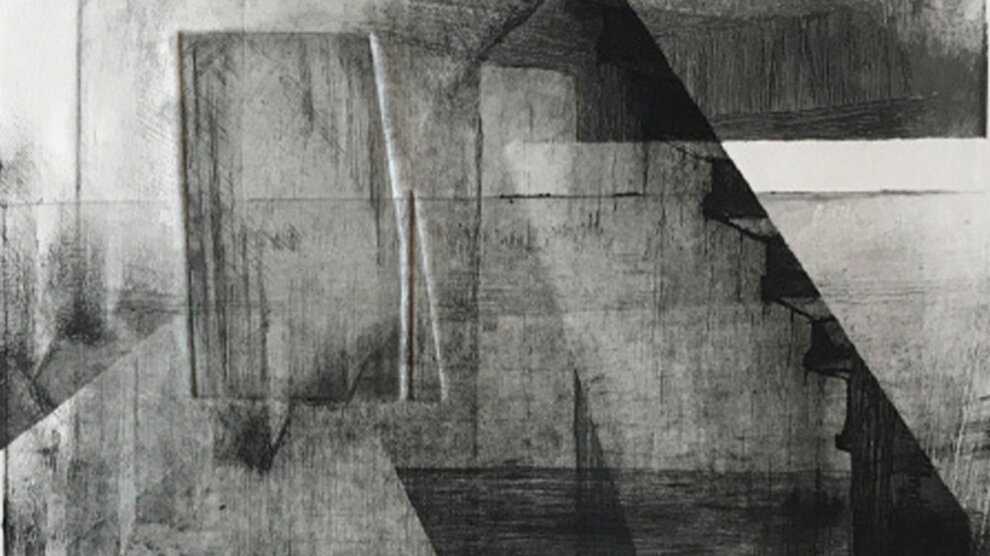
Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité