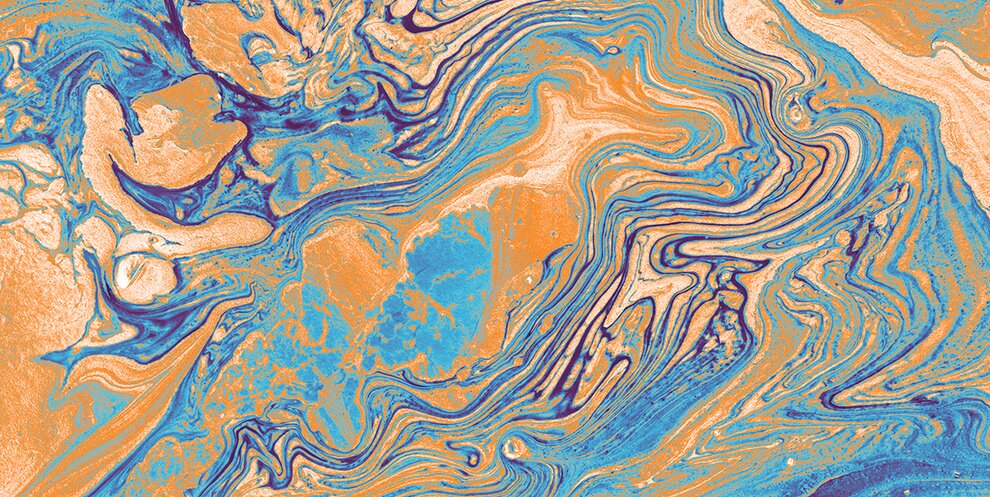Terrorisme, radicalisation, islam


Peut-on proposer une définition du terrorisme qui soit scientifiquement valide ?
Marc Sageman : Le terme terrorisme est avant tout juridique et non un concept scientifique. Il dérive d’un compromis entre juristes, datant des années 30 afin de créer une nouvelle typologie criminelle pour faciliter l’extradition des auteurs. Il se réfère ainsi à un processus mettant en danger une communauté ou créant un climat de terreur.
Si beaucoup utilisent ce terme dès qu’on parle de violence politique, attention à ne pas oublier sa dimension réflexive : le terroriste des uns, c’est le combattant pour la liberté des autres.
J’ai adopté ce besoin de réflexivité dans ma nouvelle définition du terrorisme, soit « une catégorie d’exogroupes usant de violence politique en temps de paix ». Mais comme le concept est mobilisé en fonction des intérêts scientifiques des uns et des autres, je ne m’attends pas à ce que l’on trouve un consensus.
Michel Wieviorka : Le mot « terrorisme », comme beaucoup d’autres, appartient au sens commun, à la vie politique, aux médias. Il est délicat de l’utiliser aussi de façon conceptuelle, la confusion menace toujours. De plus, le droit, Marc Sageman a raison de le souligner, a besoin d’une définition permettant de faire fonctionner la justice, de sanctionner certains faits, de faire consensus s’il s’agit du droit international.
Du point de vue sociologique, le terrorisme relève de deux logiques principales qui doivent intervenir dans sa conceptualisation. D’une part, il est instrumental : les acteurs l’utilisent comme une ressource présentant un coût, limité, pour d’immenses avantages escomptés : une simple bombe, par exemple, ou l’usage d’une arme à feu supposés déboucher sur des changements en profondeur dans la vie d’un pays.
Et d’autre part, le terrorisme fait sens aux yeux de ses protagonistes, avec ceci de particulier qu’il conjugue perte de sens – il parle de façon artificielle au nom d’une classe, d’un peuple, d’une nation, d’une communauté qui ne se reconnaît pas dans sa violence – et pléthore, recharge ou surcharge de sens – il se dote d’une idéologie, de significations religieuses.
Le terrorisme est donc calcul et stratégie, d’une part, et perte et surcharge de sens d’autre part. C’est ce que j’ai montré dans mon livre Sociétés et terrorisme (Fayard, 1988), en étudiant par exemple le terrorisme italien d’extrême gauche, qui parlait au nom d’un prolétariat ouvrier qui ne comprenait pas ses crimes, ou celui de l’ETA d’autant plus violent qu’il exprimait un mythe national et populaire devenant intenable.
Comment le terrorisme contemporain rompt-il avec, ou au contraire, s’inscrit-il dans une tendance initiée dans les années 1960 ?
M.S. : Le terrorisme contemporain prend racine dans une certaine forme de violence politique datant de la Révolution française, comme je l’explique dans mon dernier ouvrage, Turning to Political Violence : The Emergence of Terrorism (Université de Pennsylvanie, 2017).
Depuis deux siècles, les auteurs de cette violence politique se sont professionnalisés, et agissent sans aucune discrimination, ciblant désormais les civils.
La technologie a accompagné cette violence. Le premier suicidé était un horloger français de Senlis, qui se fit exploser en décembre 1789, tuant 25 autres personnes, un record inégalé pendant un siècle.
Puis, la première attaque à la bombe se fit à l’aide d’une machine infernale utilisée contre Bonaparte la veille de Noël 1800, rue Saint-Nicaise à Paris.
Le terrorisme des années 1960-70 s’est graduellement concentré sur les « capitalistes », l’État (dans le cas de l’extrême gauche radicale) ou des populations précises (extrême-droite suprémaciste).
On peut dire que la nouveauté réside dans le fait que la violence terroriste actuelle est fomentée en dehors de l’Occident, ciblant « l’Occident » en soi. Ce n’était pas le cas il y a cinquante ans.
M.W. : Le tournant s’est opéré au milieu des années 80. Avant, nous avons connu le terrorisme interne, d’extrême gauche ou d’extrême droite, ou séparatiste, comme avec l’ETA au Pays basque espagnol, et le terrorisme international, à commencer par celui se réclamant de la cause palestinienne.
Nous avons aujourd’hui un terrorisme global, qui mêle des dimensions internes et des dimensions géopolitiques, la crise des banlieues, par exemple avec les conflits du Moyen-Orient. Ce terrorisme, qui est souvent religieux, peut être martyriste, renouvelant profondément cette forme extrême de violence. Par ailleurs, la violence politique au nom de la religion n’est pas le monopole de l’islam radical : il existe ainsi un terrorisme hindouiste ou bouddhiste si l’on pense aux atrocités commises contre les Rohingya en Birmanie.
Comment le terrorisme affecte-t-il les sociétés françaises ou américaines ?
M.S. : L’impact le plus important de ces dernières années s’observe dans la réponse des Etats face aux vagues terroristes : l’émergence d’un état sécuritaire.
Or, cette réponse est celle prise en situation de guerre internationale, où l’on tente de contenir toute infiltration ennemie. C’est assez troublant car les récents outils technologiques de surveillance peuvent, dans ce contexte, être détournés et utilisés contre n’importe quel dissident politique.
Au long terme, lorsque le vague terrorisme faiblira, ces outils et la capacité de l’état à les utiliser resteront en place, menaçant les libertés individuelles.
Seules les discussions sociétales permettront de trouver un équilibre entre sécurité et vie privée et limiteront les abus. Or cet équilibre n’est possible qu’en fonction du sentiment d’insécurité de la société.
M.W. : Je suis d’accord : le terrorisme encourage des mesures sécuritaires qui affaiblissent la démocratie, en accordant au pouvoir exécutif le droit de court-circuiter la justice au nom de la nécessaire sécurité, mais non sans risques ou abus.
Le terrorisme mine aussi la légitimité des autorités politiques, toujours suspectes de ne pas faire tout ce qu’il faudrait pour assurer la sécurité des citoyens. Il renforce la défiance généralisée. Il génère des inquiétudes sur l’avenir. Il exerce aussi un impact économique, faisant par exemple fuir au moins provisoirement les touristes, obligeant à des dépenses publiques renforcées pour assurer la sécurité. Il pèse aussi sur la conduite des relations internationales, encourageant certaines alliances par exemple. Et à plus long terme, il pose des questions lourdes qui appellent des politiques publiques renouvelées, par exemple en matière d’éducation, d’accès à l’emploi, de lutte contre les discriminations.
Marc Sageman, vous avez conçu le terme de « terroriste maison ». Aujourd’hui le retour de ceux partis faire le « djihad » en Syrie signe-t-il un nouveau phénomène et un changement dans la façon dont le terrorisme pourrait s’étendre ?
M.S. : Non. Il s’agit d’un phénomène assez commun depuis le XVIIe siècle, lorsque l’arène politique s’est ouverte aux citoyens ordinaires. Certains sont partis défendre des idéaux universels à la période de la Révolution française : c’est grâce à eux que les Américains doivent leur indépendance.
Pensons aussi aux guerres d’indépendance grecques (1821-1829), yougoslaves, ceux ayant rejoint les rangs des résistants au franquisme, puis, plus proche de nous ceux qui ont combattu contre l’invasion soviétique en Afghanistan mais aussi au sein d’autres conflits globalisés.
Tous ceux qui sont rentrés ont été accueillis avec suspicion. Or à de rares exceptions, les attaques massives que l’on craignait n’ont jamais eu lieu comme le décrit le journaliste David Thomson dans son ouvrage, Les Revenants.
Ces « revenants » doivent être certes surveillés mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils rentrent chez eux tous porteurs de projets terroristes.
Si les pouvoirs occidentaux éradiquent Daech d’une manière juste, nous ne devrions pas subir une vague d’attaques dans les pays d’origine. Le processus est plus proche de celui d’une démobilisation après une guerre internationale. Les soldats démobilisés souvent tentent de reprendre le cours interrompu de leurs vies.
M.W. : On a parfois comparé les jeunes gens allant de France rejoindre Daech en Syrie avec ceux qui rejoignaient les Brigades internationales en 1936.
Mais il n’y a rien de comparable entre la sociologie des sympathisants des brigades de 1936, et celle des djihadistes. Et aujourd’hui on ne peut dissocier les aspects domestiques, sociaux de la violence et les dimensions étrangères : l’action permet de combiner les deux, de conférer un sens à l’existence en rejoignant le combat au Moyen-Orient depuis un quartier populaire francilien ou depuis un village normand. C’est pourquoi il faut parler de terrorisme global, c’est-à-dire conjuguant des significations locales, nationales et étrangères.
Que pensez-vous du terme radicalisation ? Est-il toujours pertinent ? Quel est son impact dans nos sociétés ?
M.S. : Il ne faut pas déconstruire ce terme. Son sens diffère selon les acteurs qui l’emploient. Nous devons en revanche être plus précis dans nos propos : la radicalisation est-elle l’adoption d’idées rejetant la société actuelle (ce qui ne s’accompagne pas forcément de violences) ou le recours à la violence politique (qui ne s’accompagne pas forcément d’idées « radicales ») ?
Nous devons trouver d’autres termes pour définir ces deux processus, très différents. La plupart des commentateurs les utilisent de façon interchangeable, souvent dans la même phrase, ce qui ajoute à la confusion.
M.W. : Le mot a eu son utilité, en insistant sur le caractère sans concession, entier, du phénomène considéré. Mais la « radicalisation » ne signifie pas nécessairement l’entrée dans des logiques terroristes, ni même violentes, et le mot risque de disqualifier ou de stigmatiser des personnes ou des groupes qui agissent, sans concession, dans un cadre démocratique. D’ailleurs en France, une grande tradition politique plutôt centriste se réclame de l’adjectif « radical » !
Un débat actuel oppose deux thèses, résumées ici : la radicalisation se forme-t-elle avant le recours à la religion ? Ou bien, la religion conduit-elle à la radicalisation politique ? Quel prisme d’analyse choisiriez-vous ?
M.S. : ces deux thèses simplifient grandement la situation et ne se fondent que sur l’un des courants actuels de violence politique. Dans mon dernier ouvrage, je propose une analyse sur la violence politique qui dépasse ce clivage. J’ai longuement interviewé une douzaine de néo-djihadistes dans différents pays, et j’ai été très surpris de leur manque de religiosité ou même de radicalisme.
Ils s’identifiaient plutôt avec les victimes du régime d’Assad et sur le fait de partager une religion commune ; et ils se refusaient à rester impuissants face aux événements. La « radicalisation » et l’« l’islamisation » se sont alors joints pour devenir inséparables dans le processus accompagnant l’outrage moral ressenti devant les massacres des membres d’une communauté virtuelle qu’ils ont imaginée et à laquelle ils s’identifient, une sorte de « néo-oummah ».
La priorité devient alors de défendre cette communauté. Pourtant, il est important de retenir que ces jeunes n’ont été ni pieux ni radicaux. Ils visionnent des vidéos, lisent les tweets de gens qu’ils connaissent et fantasment à l’idée d’être reconnus comme de glorieux guerriers au sein de leur communauté autoréférentielle. Il faut aller cependant au-delà de cette controverse si l’on veut réellement comprendre la complexité des phénomènes actuels.
M.W. : J’aurais ici un léger désaccord, je pense que ce débat, même simplificateur et maladroitement formulé, nous oblige à réfléchir à une grande question : quel est le statut de la religion dans ce terrorisme islamique ?
Les observations empiriques, comme celles d’Olivier Roy ou de Farhad Khosrokhavar montrent souvent que l’islam vient plus ou moins tardivement animer la conscience des acteurs, mais cela n’empêche pas de constater que sans l’islam, et quelle que soit la pauvreté de son contenu chez les acteurs, il n’y a pas passage à l’acte, l’action ne trouve pas son sens.
Cela évidemment n’interdit pas d’analyser la façon dont s’effectue la « radicalisation », à partir de processus sociaux dont les banlieues populaires et les enfants de l’immigration n’ont pas le monopole.
Il n’y a pas un modèle unique expliquant les actes terroristes, mais une certaine diversité, avec ceci de particulier qu’il y faut un sens religieux pour qu’il y ait décision d’agir. Mais ce débat ne laisse pas de place à d’autres hypothèses, et notamment à l’idée, chère à certains psychanalystes, qu’il peut y avoir aussi des dimensions pathologiques dans certains cas au moins, des failles qui relèveraient aussi de la psychiatrie.
Cet article est paru dans The Conversation, le 1er novembre 2017

Marché du livre marocain : les Éditions de la MSH engagées dans les dynamiques internationales du livre

Index de l'égalité professionnelle 2025

La FMSH et le Social Science Research Council posent la première pierre d’une coopération internationale