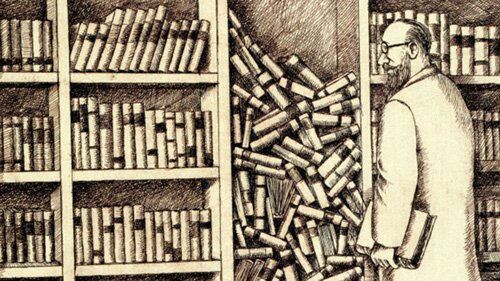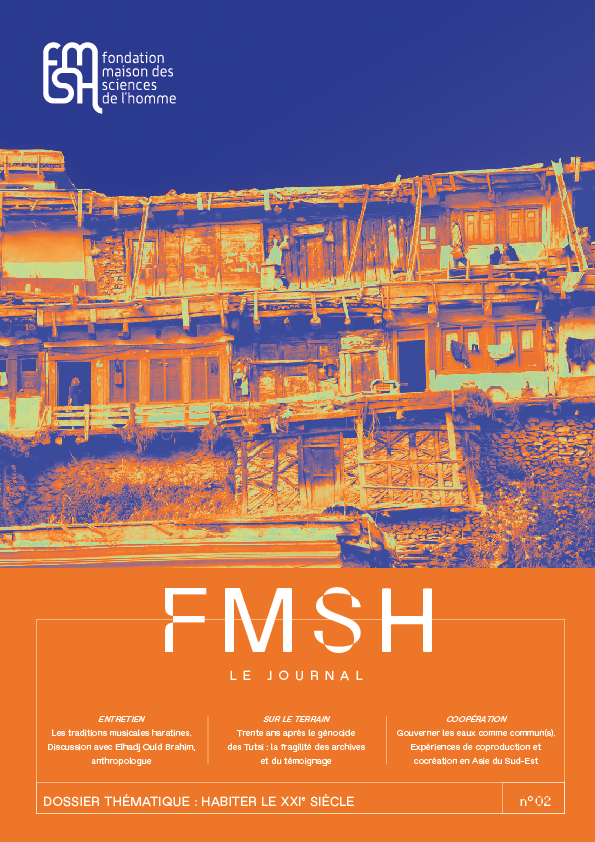Accueil, partage et échanges à la Maison Suger

Découvrez ce lieu d’exception avec Gwenaëlle Léonus-Lieppe, directrice de la Maison Suger.
Quelles sont les missions de la Maison Suger ?
La Maison Suger a été conçue, à l’initiative de la FMSH, comme un « Centre international de recherche, d’accueil et de coopération pour chercheurs étrangers ». Elle constituait une nouvelle étape du développement de la FMSH, en favorisant les synergies entre les disciplines des SHS, les collaborations entre établissements scientifiques parisiens et étrangers, ainsi que le développement de réseaux internationaux. Lieu de vie, de travail intellectuel et de coopération, elle devait et doit toujours satisfaire aux exigences du travail individuel et de la réflexion collective. Les cinq missions de la Maison sont d’accueillir les chercheurs étrangers, de promouvoir les échanges internationaux, de favoriser l’interdisciplinarité, d’offrir des outils de travail adaptés aux besoins des chercheurs et propices au développement de la recherche, enfin, de « faire Maison ». La Maison Suger est le fruit d’une vision de Fernand Braudel, réalisée par Clemens Heller : elle avait pour vocation de contribuer à conforter le rôle de Paris comme lieu incontournable de rencontres et d’échanges intellectuels d’excellence dans la tradition de la peregrinatio academica.
A wonderful "home away from home"
La Maison a ouvert ses portes il y a près de 35 ans, pouvez-vous nous en dévoiler davantage sur son histoire ?
Elle occupe un ancien hôtel particulier érigé au début du XVIIe siècle et remanié à la fin du siècle suivant. À partir de 1818 et pour 150 ans, les bâtiments furent la propriété de l’entreprise Lorilleux, pionnière dans l’industrie des encres d’imprimerie. En 1967, l’État a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier pour y installer des services de l’académie de Paris. Délaissés pour cause de vétusté, les lieux restèrent inoccupés jusqu’en 1987, quand le Ministère de l’Éducation Nationale les mit à la disposition de la FMSH. Un bail emphytéotique de 40 ans fut signé entre les parties, à charge pour la FMSH de financer la reconstruction et l’entretien de ce centre de recherche pour chercheurs étrangers. Une levée de fonds internationale auprès de donateurs publics et privés a permis de réaliser le projet confié à l’architecte Antoine Grumbach. Après plus de deux ans de travaux, la résidence accueillait ses premiers chercheurs en janvier 1990.
L’ambition de Fernand Braudel s’est traduite dans la réalisation architecturale : la rénovation a opportunément conservé les parties anciennes, confortées par une ossature et des parties modernes dédiées aux circulations. La résidence était également dotée d’équipements de pointe pour l’époque, symboles du renouveau de la recherche. Le projet d’Antoine Grumbach, d’une « Babel réconciliée », incarne toujours les valeurs de la FMSH et de la Maison : promouvoir l’accueil et le partage, favoriser les échanges humains et professionnels, la solidarité internationale, la tolérance par-delà les frontières linguistiques et les différences culturelles, les courants de pensée ou la diversité des formations académiques.
Nous approchons des 40 ans de la signature du bail : quelles perspectives pour la suite ?
En effet, le bail arrivera à échéance en janvier 2027. Sans préjuger d’une décision qui appartient à l’État, la FMSH a déjà à cœur de démontrer le succès de cette réalisation – dont elle revendique l’initiative et le modèle – et l’importance des services que la Maison rend aux communautés de recherche en SHS depuis 1990. Les résidents et les établissements de recherche en Île-de-France sont d’ailleurs nos meilleurs ambassadeurs. La Maison est un bel endroit, un beau dispositif, qui demande des investissements non négligeables. Durant 40 ans, la FMSH en a assumé les coûts de fonctionnement et de maintenance, l’ensemble est en très bon état. Elle entend démontrer sa capacité à lui donner une seconde jeunesse, si l’État lui en donne l’opportunité et lui conserve sa confiance.
Si la Maison Suger n’existait pas déjà, il faudrait l’inventer tout de suite !
Quel est le dispositif d’accueil des résidents ?
La résidence dispose de 33 logements, de la studette au deux-pièces, permettant d’accueillir environ 170 résidents par an, pour un à douze mois. Sont éligibles les chercheurs et chercheuses étrangers à partir du postdoctorat, issus de toutes les disciplines des SHS. Les candidatures sont sélectionnées par une commission d’attribution qui se réunit tous les mois, composée des directrices scientifiques de la FMSH et qui devrait bientôt s’appuyer sur l’expertise de membres du conseil scientifique. Outre la qualité du dossier et la pertinence du séjour à Paris, la commission prend en considération certains critères : elle veille à l’équilibre de la représentativité hommes/femmes, des pays d’origine des candidats, des disciplines de rattachement ou encore des institutions invitantes. Une attention particulière est accordée aux primo demandeurs, aux chercheurs en début de carrière ou rencontrant des difficultés politiques ou économiques. La Maison héberge notamment les chercheurs bénéficiaires des programmes de mobilité de la FMSH (Atlas, Themis, DEA) ou des lauréats du programme PAUSE. Les résidents s’acquittent d’un loyer calculé au plus près des coûts de fonctionnement de la résidence. La FMSH supporte 30 à 35 % des coûts réels des logements, soit environ 180 000 € en 2024.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la programmation scientifique ?
Elle a pour but de valoriser les travaux des résidents, favoriser les rencontres scientifiques, le partage des approches, des méthodes et des savoirs. Elle offre l’opportunité de confronter les problématiques interdisciplinaires et d’impulser les collaborations. Dans le cadre des « Jeudis de la Maison Suger » par exemple, les résidents sont invités à présenter leur recherche en cours. La Maison soutient les initiatives collectives organisées par ses résidents et héberge chaque année cinq ou six séminaires de recherche. Sont sélectionnés les projets qui répondent aux critères promus par la FMSH : l’interdisciplinarité, les collaborations institutionnelles, l’ouverture internationale et sur la société, le caractère novateur ou différenciant des formats. Outre ces séminaires récurrents, la Maison accueille des rencontres scientifiques variées (ateliers, colloques, écoles d’été, présentations d’ouvrages, conférences, performances…) organisées par la FMSH ou par des institutions partenaires. Ces rencontres doivent constituer une offre pour les résidents et des opportunités d’ouverture sur des communautés scientifiques. Elles doivent aussi s’articuler aux axes thématiques, aux dispositifs soutenus et aux valeurs portées par la Fondation.
Knut Ove Eliassen revient sur son expérience à la Maison Suger
Article paru dans le deuxième numéro du Journal de la FMSH.
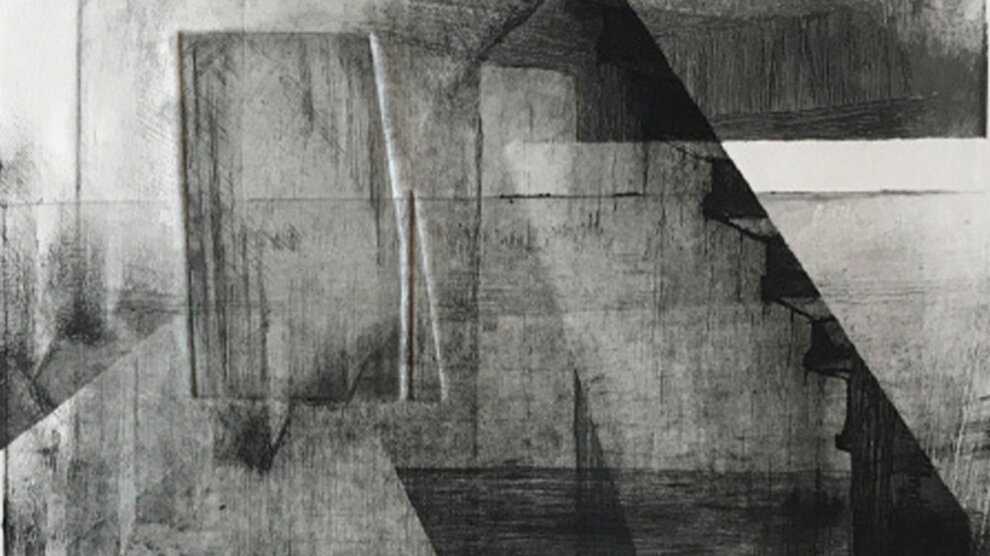
Le coopérisme

De la rue à la mairie

Maternités autorisées, maternités proscrites