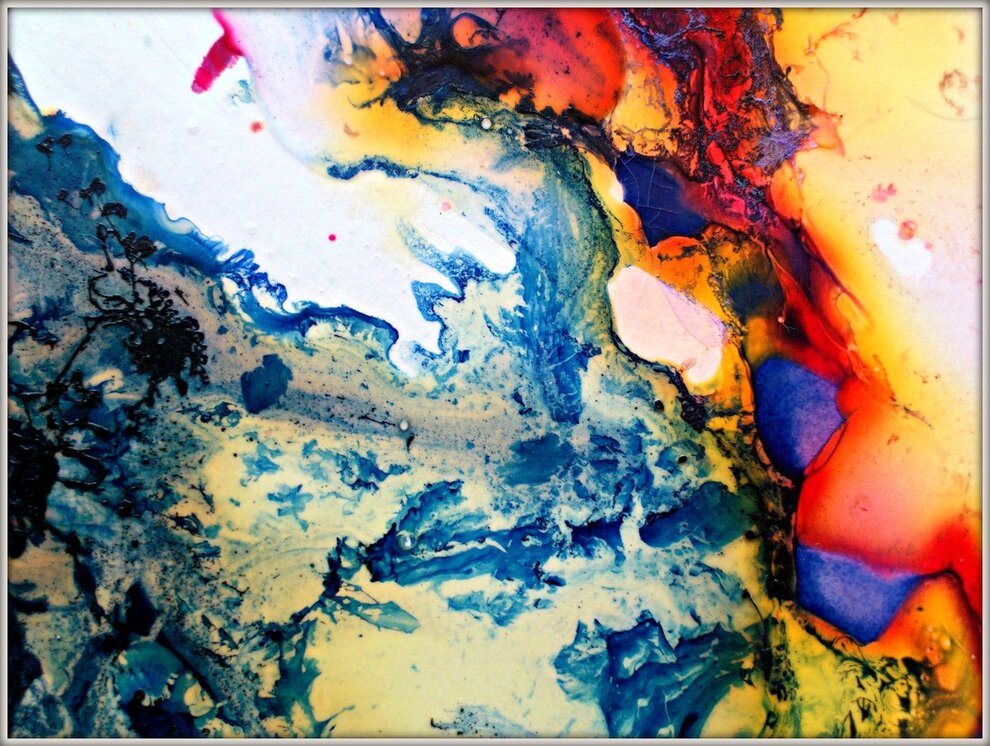Les espaces de la théorie : topologies et expériences de la pensée
Séminaire International de Sémiotique à Paris
Mercredi
22
mars
2023
13:45
17:00
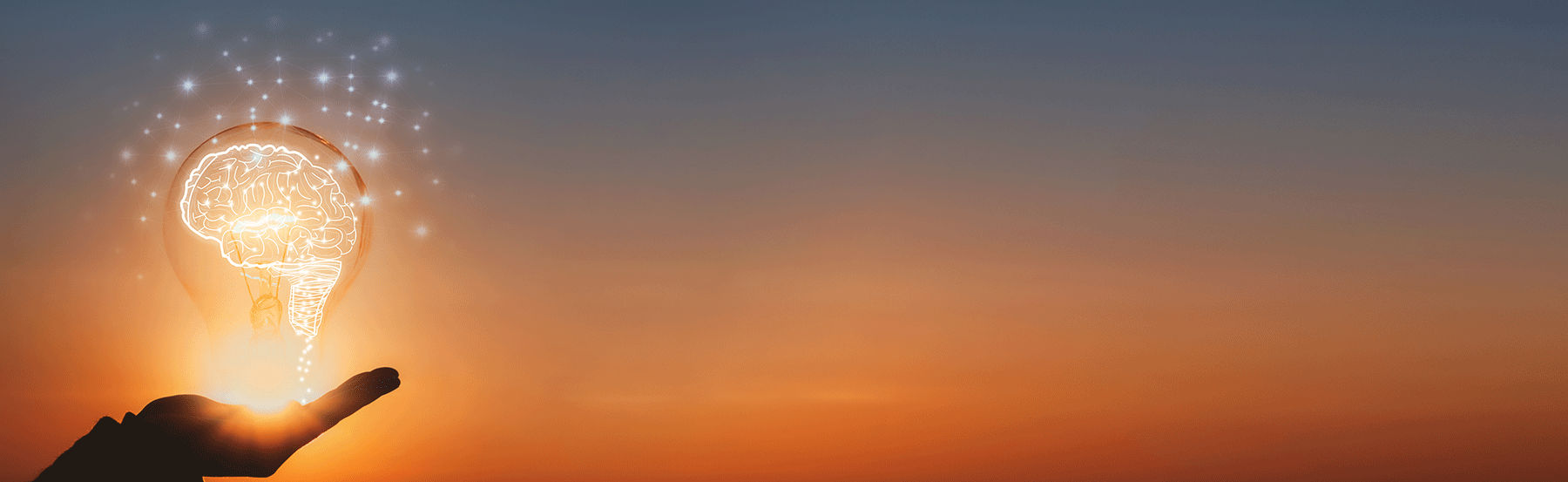
Publié le 22 mars 2023